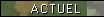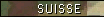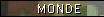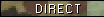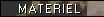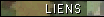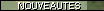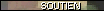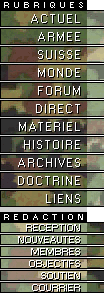










Guerre asymétrique et droit international : pour un nouveau traitement juridique de la fracture de paix
9 mai 2004

e droit actuel des conflits armés porte avant tout sur la guerre symétrique, et n'aborde la question des entités non étatiques que sous l'angle humanitaire, ce qui leur accorde des avantages considérables. Pourtant, le Droit de la Haye permet aux États d'envisager une resymétrisation à même de renforcer la sécurité des démocraties.
Beaucoup de littérature a fleuri sur le concept de guerre asymétrique depuis le 11 septembre. On parle le plus souvent de stratégie du faible au fort, par laquelle l'attaquant qui ne disposerait pas d'un arsenal, non seulement classique mais en outre, d'une puissance létale concurrentielle avec les grandes et moyennes puissances, se retrouverait « réduit » voire « contraint » à utiliser des moyens non conventionnels pour réussir.
Au-delà de l'approximation d'une telle analyse, qui omet le principe de guerre par procuration, tout à fait envisageable pour une ou plusieurs puissances, c'est la limitation du concept à son aspect capacitaire qui nous semble poser problème. En effet, l'un des déterminants de base d'une guerre asymétrique ne se trouve pas seulement dans l'usage de techniques non conventionnelles, voire « hors limites » [1] ou même dans les finalités plus ou moins nihilistes du conflit provoqué, mais aussi dans le droit de la guerre qui lui est applicable.
Le droit de la guerre classique repose en effet sur une symétrie indéfectible, en ce sens que celui contre qui on est en guerre, est censé l'être aussi. La symétrie résulte de cet état de belligérance conjoint et réciproque qui est l'apanage des États souverains. Depuis les tentatives de bannissement de la guerre ( outlawry of war) par le pacte de la SdN de 1919 [2], la guerre est toujours conçue, du point de vue du droit international, quasi-exclusivement comme une question symétrique entre États souverains [3].
Or, en situation de guerre asymétrique, c'est bien l'état juridique de guerre qui va changer. En effet, l'état de guerre ne vaudra plus que pour l'une des parties, généralement l'attaquant. Par exemple, lorsque tel groupe armé privé déclare le djihad à tel ou tel pays, le premier est en guerre mais pas nécessairement le second, qui n'y verra souvent qu'une incantation lointaine, même si elle demeure inquiétante, pour la bonne raison qu'elle n'émane pas d'un État souverain.
Certes, il existe bien tout un pan du droit international applicable aux entités guerrières non étatiques, mais il s'agit essentiellement de droit humanitaire [4], dont les combattants non étatiques peuvent bénéficier eux-mêmes, sous certaines conditions[5]. En conséquence, lorsque l'attaquant n'est pas (ou pas directement) un État souverain ( stateless warfare) mais un groupe armé privé, la réplique militaire classique d'État à État n'est juridiquement plus envisagée, dans le sens où il n'est pas prévu de lui déclarer un état de guerre spécifique, géré par l'armée et ses règles d'engagement.
Les alternatives de riposte pour l'État
Les résultats d'un tel vide conceptuel sont tout de même faramineux. Qui aurait cru, par exemple en pleine guerre froide, que l'acte de guerre le plus dangereux qui soit, consistant à lancer sur le Pentagone un missile de croisière, aurait pu s'effectuer sans que la moindre riposte militaire directe des États-Unis soit possible, dès lors qu'il fut bricolé sous forme d'avion détourné et piloté par des militaires sans uniforme? C'est tout l'art de la guerre asymétrique que de « scotcher » ainsi sa victime. Les groupes armés qui ont conçu cette opération, connaissaient fort bien leur périmètre stratégique d'intervention.
Quelles sont dès lors les alternatives de riposte pour un État souverain et démocratique ?
a) Conflit asymétrique interne
Si le groupe armé privé est installé dans les frontières de l'État attaqué, la riposte sera obligatoirement une opération de police interne suivie, en cas de succès aléatoire de l'enquête, d'une séquence judiciaire à l'issue incertaine.
b) Conflit asymétrique international coopératif
Si le groupe armé privé est installé au sein d'un État tiers, il sera de la responsabilité discrétionnaire de ce dernier de faire la police chez lui [6]. S'il n'en a pas les moyens, il pourra soit autoriser l'État attaqué à quelques opérations de police communes, voire militaires, comme c'est le cas au Pakistan, soit demander l'assistance d'autres États, comme le fait aujourd'hui l'Afghanistan, soit combiner les deux solutions.
c) Conflit asymétrique international non coopératif
L'État souverain, hébergeur du groupe armé, pourra également nier l'existence de ce dernier dans ses frontières, soit encore refuser purement et simplement d'intervenir.
Si l'État attaqué estime que cette absence de réaction s'apparente à de la complicité, voire même à de la co-action, il pourra alors éventuellement attaquer l'État hébergeur, au nom de la légitime défense [7], à charge de démontrer cette complicité devant l'ONU, dans une logique parajudiciaire relativement complexe et laborieuse.
d) Conflit asymétrique avec extranéité infra étatique
Dans l'hypothèse où c'est un proto-État qui héberge le groupe armé privé, le système s'amplifie. L'État attaqué ne pourra exiger du proto-État non souverain de faire totalement la police chez lui. En outre, le groupe armé pourra aspirer lui-même au pouvoir, et dès lors lui dénier cette légitimité de police, voire le menacer de créer les conditions d'une guerre civile, classique celle-là. Il bénéficiera même, le cas échéant, du droit humanitaire applicable aux Mouvements de Libération Nationale, au titre de l'article 96 du Protocole additionnel I de 1977 [8]. L'État attaqué ne peut davantage faire une guerre classique directe au proto-État dans la mesure où, justement, il n'est pas un État. Certains stratèges du proto-État auront d'ailleurs compris tout leur intérêt à faire perdurer leur situation de droit non abouti, afin de se préserver d'une riposte militaire classique.
Tout cela va donc s'inscrire dans un dédale de décisions politiques et juridiques volatiles, situées à l'opposé de l'unité de commandement généralement de rigueur en situation de guerre. Le guerrier asymétrique double ainsi son avantage d'origine qu'est le recours à une attaque surprise hors limite, par une probabilité de riposte très amortie. Le bilan coût/avantage lui est favorable et les logiques de dissuasion encore inexistantes [9].
Les démocraties n'ayant intégré l'état de guerre qu'entre États souverains, elles cantonnent donc prioritairement leur réplique à la gestion criminelle de droit commun. L'ONU n'ayant quant à elle été conçue que pour calmer les ardeurs de la guerre symétrique, elle a le plus grand mal à traiter les déclarations de guerre, même officielles, émanant des groupes armés privés optant pour l'asymétrie [10].
Il en résulte que, du point de vue du droit à entrer en guerre (ius ad bellum), l'attaqué n'étant pas en guerre réciproque contre l'attaquant, il n'aura finalement le choix qu'entre seulement deux solutions.
a) Le déni de guerre.
C'est la voie choisie par différents États alignés sur les positions des mouvements pacifistes, lors du déclenchement de la guerre d'Irak. Il s'agit alors d'une position qui s'apparente au syndrome de Stockholm en politique et que l'on a vu s'appliquer en Espagne après les attentats du 11 mars. Dans le cas des États seulement attaquables et non encore attaqués, on pourrait même parler d'un syndrome de Stockholm antérograde. En effet, l'État attaquable développe généralement un sentiment de confiance, voire de sympathie envers certains instigateurs de la guerre asymétrique dont il peut être victime. On n'a vu aucune manifestation particulière d'hostilité directe à l'égard de certains tenants du salafisme ou du wahhabisme par exemple, qui furent sans conteste les sources d'inspiration essentielles, voire même de commandement, des guerriers du 11 septembre et du 11 mars. On a vu en revanche se développer une réelle hostilité des pacifistes envers les autorités des pays victimes.
b) La riposte militaire unilatérale
L'État attaqué qui décidera unilatéralement de riposter militairement devra alors supporter l'ire de la Communauté internationale lui déniant le droit de gérer sa guerre. En effet, face à un non État, il apparaîtra assez mécaniquement comme un transgresseur du droit international. C'est notamment le cas de l'État d'Israël qui se voit reprocher des actes « extrajudiciaires » [11] lorsqu'il élimine deux officiers supérieurs d'une armée sans uniforme (les officiers Yacine et Rantissi).
Les réponses juridiques disponibles
Pour l'heure et pour l'Europe, espérons que nos démocraties se réveilleront un jour et viendront enfin nous expliquer publiquement, depuis la tribune de l'ONU, que le terrorisme étant un acte de guerre et non un acte de droit commun, il devrait être passible d'une procédure d'engagement militaire repensée, spécialement en termes juridiques.
L'alliage du renseignement intégré, des frappes préventives, de la rétention militaire de type Guantanamo, de la contre-subversion active, voire même tout simplement l'engagement de l'armée dans les tâches de protection comme celles du G8, du symposium de Davos ou des ambassades, en font sans doute déjà partie sur le plan technique. Qu'en serait-il juridiquement ?
En remontant au corpus du « Droit de La Haye », datant de 1899 et 1907 et toujours en vigueur au bénéfice des quelques fusions avec le droit humanitaire de Genève et ses Protocoles additionnels, on observe que les guerriers asymétriques s'autorisent tout ce qui est, justement et formellement, prévu et interdit par les conventions relatives à la conduite des hostilités dans les conflits armés ( ius in bello), dont ils ne sont évidemment pas signataires.
L'article 51 §2 du Protocole additionnel I de 1977, résume à lui seul le champ d'interdiction en ces termes : « Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne doivent être l'objet d'attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violences dont le but principale est de répandre la terreur parmi la population civile ».
Mais l'arsenal juridique des conventions internationales englobe beaucoup plus largement les techniques de guerre asymétrique:
- attaques directes interdites des personnes civiles (articles 48 et 51 du Protocole additionnel),
- utilisation interdite de non-combattants pour protéger des objectifs militaires
- obligation d'éloigner les objectifs militaires des zones peuplées (Convention de Genève III),
- attaques interdites des biens civils (article 52 du Protocole additionnel I)
- attaques indiscriminées interdites (articles 51 § 4 et 5 du Protocole additionnel I),
- attaques interdites des localités non défendues (article 59 §1 du Protocole I),
- attaques interdites des zones neutres, démilitarisées et/ou sanitaires (articles 14 et 15 de la Convention de Genève IV et 23 de Genève I),
- attaque interdite des biens indispensables à la survie de la population civile, des biens culturels, des lieux de culte (articles 53 et 54 Protocole additionnel I),
- atteintes interdites à l'environnement naturel (article 55 Protocole additionnel I),
- enrôlements interdits des enfants (articles 53 §1 Convention Genève I),
- attaques interdites des ouvrages d'art contenant des forces dangereuses (article 56 Protocole additionnel I),
- etc.
Les dispositifs internationaux prévoient également la prohibition d'armes aggravant les propriétés létales et causant des maux supplémentaires et indiscriminés (comme les clous des bombes terroristes) mais aussi les méthodes typiques de la guerre asymétrique, comme la « perfidie » (articles 53 §1 Convention Genève I, 45 Convention Genève II, 37-39 Protocole additionnel I). Cette dernière méthode comprend par exemple les feintes suivantes :
- fausse intention de négocier,
- fausse intention de reddition,
- fausse incapacité (blessure ou maladie) mais sans doute aussi juridique,
- faux statut de non combattant,
- faux statut protégé (diplomatique, sanitaire), etc.
Mais en outre, c'est toute la logique juridique de la guerre asymétrique qui est visée par les conventions internationales, lorsque celles-ci prohibent les « … actes qui trompent la bonne foi de l'adversaire en utilisant à des fins hostiles l'obligation de celui-ci de respecter des règles du droit des conflits armés… » [12]. On constate ainsi avec étonnement que le Droit de La Haye a à peu près tout prévu des actes de guerre que le terrorisme fait subir à ses victimes.
La question est alors la suivante : comment se fait-il que, disposant d'un tel canevas juridique, on continue de traquer les guerriers asymétriques selon les règles civiles et pénales internes de droit commun ? Comment se fait-il qu'aucun organe international n'ait encore inscrit à son ordre du jour une extension expresse aux conflits asymétriques, et dans l'ordre interne, du corpus de La Haye ? [13]
C'est en effet ce transfert à l'ordre interne qui parait juridiquement le plus prometteur, dans la mesure où tous les principes en sont déjà acquis en droit positif. Il se ferait en quelque sorte à rebours du ius in bello dont la raison d'être est justement de restreindre l'action guerrière. Il passerait dès lors par une reformulation du droit d'entrer en guerre : le ius ad bellum.
Cette internalisation du droit conventionnel aurait en effet le mérite de répondre à la dilution de l'élément territorial dans les conflits asymétriques en restituant son rôle premier à l'armée, qui est de protéger ses concitoyens contre toutes formes de guerre.
Contre une déclaration ou une situation de guerre asymétrique, on peut imaginer un droit de police interne, militaire et distinct du droit commun. Ce droit serait comparable à celui d'un état de siège, qui serait ratione materiae (en considération de l'acte) plutôt qu'exclusivement ratione loci (en considération du territoire).
Dès lors qu'un groupe armé privé s'engagerait dans des actions prohibées par le droit de la Haye, les règles d'engagement militaires trouveraient à s'appliquer et non plus le droit pénal classique. En d'autres termes, par son entrée en guerre asymétrique, le terroriste prendrait le risque d'une réplique militaire systématique et réduirait fortement ses chances d'obtenir une porte de sortie judiciaire. Cela se traduirait en particulier par une requalification du combattant sous le terme « d'ennemi » et non plus de terroriste tout court. Il serait alors voué à supporter les conséquences de ses actes en termes d'élimination physique et ciblée de sa personne, de contrôle de sa doctrine de guerre et de responsabilisation directe de sa chaîne de commandement et d'inspiration.
Deux questions se posent pour basculer du droit commun au ius ad bellum : la qualification de l'acte et la preuve. L'acte, comme on l'a vu plus haut, est déjà largement qualifié par le droit international actuel. Le système de preuve pourrait aller de la prise en compte des déclarations et appels à la guerre jusqu'à un renversement de charge, très classique dans les démocraties, pour les actes secrets. A ce titre, ce serait à celui qui se retrouverait dans la situation qualifiée d'acte de guerre (consommé ou préparatoire), qu'il appartiendrait de prouver qu'il commet ou envisage de commettre un acte criminel détachable d'un acte de guerre.
S'agissant des garanties humanitaires applicables, on les trouve déjà au complet dans le Droit de Genève. Il n'y a donc pas à s'étendre sur ce sujet.
S'agissant du fait d'internalisation, rien à réinventer non plus. On pourrait en effet s'inspirer du principe de « reconnaissance de belligérance » qui fonctionna jusqu'aux lendemains de la Seconde guerre mondiale. Il s'agissait d'un acte unilatéral d'un État envers une entité armée non étatique, destiné à lui appliquer les règles du conflit armé, généralement dans le cadre d'une dispute territoriale. Cette reconnaissance s'appliquerait ici du fait de l'acte.
La réduction de la « fracture de paix », causée par la guerre asymétrique, devrait pouvoir donner le jour à un système de mandat d'intervention spécial au bénéfice de l'État victime. Ce mandat lui donnerait un droit spécial d'ingérence dans les pays d'accueil des groupes armés, qui seraient réfractaires ou insuffisamment équipés, sous le contrôle très strict d'une instance internationale d'instruction. Le droit commun reprendrait sa place en cas de légitime défense.
On imagine d'ici les oppositions classiques au droit d'ingérence, relatives à la souveraineté de l'État réfractaire. S'agissant d'un droit d'ingérence non humanitaire, s'y ajouterait la crainte de voir tout refus dégénérer en conflit, bien symétrique celui-là. Mais n'est-ce pas en explorant ces pistes que l'on pourra mieux révéler les responsabilités des uns et des autres ? N'est-ce pas dans la « resymétrisation » que la dissuasion pourra retrouver de son efficacité, justement ?
La logique de guerre par procuration qui sous-tend la protection d'un groupe armé privé, aurait-elle toujours autant d'efficacité si l'immunité de l'État d'accueil complice se trouvait réellement remise en question ? Il deviendrait en toute hypothèse plus difficile d'accuser tel ou tel État de sortir du droit international lorsqu'il fonderait justement son intervention de police sur lui.
N'est-ce pas en effet le rôle des démocraties de s'entendre pour se protéger, légalement et solidairement, d'attaques dont elles ont tout prévu depuis un siècle ? N'est-ce pas également le rôle de l'ONU de renforcer les démocraties de ce point de vue précis ? En revanche, si le fonctionnement de cette vénérable institution conduisait à faire la vie facile aux guerriers asymétriques, ils auraient réussi un formidable retournement de sa raison d'être et de sa charte.
Arnaud Dotézac, avocat
|
Bibliographie complémentaire |
[1] Qiao Liang et Wang Xiangsui, « La guerre hors limites » Rivages, Paris 2003
[2] Le pacte interdisait la guerre d'agression, la guerre non précédée d'une tentative de médiation ou enfreignant une décision juridictionnelle
[3] La résolution de l'ONU 3314 (XXIX): du 14 décembre 1974 définit l'agression armée comme « l'emploi de la force armée par un Etat (souligné par nous) contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la charte des Nations Unies ».
[4] Cf. La doctrine, notamment à travers les travaux de l'Institut de droit international, soutient que les entités non étatiques ont l'obligation de respecter les conventions de Genève (Annuaire de l'Institut de Droit international, vol 68-I 1999, p. 329).
[5] Articles 43 et 44 du Protocole additionnel I de 1977, peuvent conférer à la plupart des combattants non étatiques la protection des prisonniers de guerre, ce qui a été considéré comme une prime au terrorisme.
[6] La superposition du pouvoir politique dans les procédures d'extraditions renforcera les incertitudes, même en cas de succès judiciaire.
[7] La résolution 1368 prise par le Conseil de sécurité de l'ONU en 2001, à la suite des attentats du 11 septembre, a en effet considéré les actes terroristes comme des menaces justifiant la légitime défense mais dans les limites des principes qui interdisent toute action préventive (article 51 de la Charte) et/ou disproportionnée.
[8] On pourra consulter les convention visées dans le présent article sur le site web Comité International de la Croix Rouge : http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/iwpList2/Humanitarian_law:Treaties_and_customary_law
[9] Le champ d'étude de la dissuasion en guerre asymétrique est considérable et encore relativement vierge. C'est pourtant bien la manifestation d'inhibiteurs à la volonté d'initier ce type de guerre qui signifiera son déclin réel. Une telle dissuasion devra s'attaquer aux fondements de la motivation dès le stade le plus embryonnaire, plutôt qu'aux armements résultants. En d'autres termes, plutôt que viser l'impuissance réciproque des Etat par leur surarmement, comme au temps de la guerre froide, il faudra réduire à l'impuissance les doctrines bellicistes asymétriques, dans le champ individuel, avec sans doute une prime aux opérations psychologiques préventives.
[10] On notera toutefois l'intéressante résolution contre l'ETA au lendemain des attentats de Madrid, qui n'a toutefois, de manière très surprenante, pas été actualisée envers le groupe islamiste finalement détecté comme responsable.
[11] Donc non conformes à une procédure pénale de droit commun.
[12] Robert Kob, « Ius in bello », ", Helbin & Lichenhahn, Bâle 2003, p. 150.
[13] On notera qu'en 1937, la SdN fit adopter deux conventions sur le terrorisme impliquant sa répression par la mise en place (déjà) d'une cour pénale internationale. Elle n'entra jamais en vigueur faute de signataires en nombre suffisant.
© 1998-2004 CheckPoint |