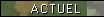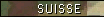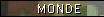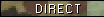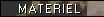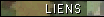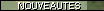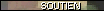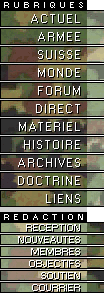










Les paradoxes de la puissance militaire américaine
déployée en Irak et en Afghanistan
23 novembre 2003

es Forces armées US disposent aujourd'hui d'une puissance inégalée, mais celle-ci est paradoxalement entravée par un ensemble de règles inadaptées et de préjugés ineptes. L'historien militaire Victor Davis Hanson en établit l'analyse.
Les critiques blâment aujourd'hui les militaires américains, qui ont désintégré les forces de Saddam Hussein du Koweït au Kurdistan en trois semaines, pour leur incapacité apparente à restaurer la civilisation en Irak - six mois seulement après la fin du cauchemar de 30 ans imposé par le même Saddam Hussein.
Aucun d'entre eux n'accorde d'importance aux faits que moins de combattants aient été tués en 2 ans d'affrontements que ceux perdus en moyenne par semaine au Vietnam, que les ennemis renversés comme les Taliban et Saddam Hussein proviennent en droite ligne des temps les plus sombres, que ces efforts soient incompréhensibles sans le 11 septembre, que des démocraties soient installées au lieu d'hommes liges tyranniques, et que reconstruire l'Irak à 11'000 km de distance semble aller plus vite que rebâtir sur le cratère de Manhattan.
Pour quelle raison ? Parce que nous sommes dans une guerre qui n'est pas vraiment une guerre, mais dont nous commençons seulement à mesurer les règles déconcertantes.
La minute impitoyable
Bien avant le refus de foncer sur Bagdad en 1991, l'incapacité à détruire un ennemi mis en déroute a souvent auguré un quasi désastre pour une force victorieuse. Pensez à la pause allemande aux abords de Dunkerque, lorsque le Corps expéditionnaire britannique s'échappait largement intact vers l'Angleterre, ou au laxisme des Alliés dans la fermeture de la poche de Falaise, à l'été 1944, qui permit à des milliers d'Allemands de s'échapper, de se regrouper et d'attaquer 6 mois plus tard dans les Ardennes.
Cependant, les conditions de la guerre nouvelle - couverture médiatique télévisée, globale et instantanée, pacifisme endémique et terrorisme post-conflit - ont rendu plus cruciale que jamais la nécessité de détruire un ennemi vacillant avant la fin des hostilités. Les conflits à proprement parler, c'est-à-dire la période pendant laquelle les belligérants s'attaquent librement l'un l'autre en un combat conventionnel, sont maintenant des plus courts, souvent une affaire de jours ou de semaines plutôt que de mois ou d'années. Et ces fenêtres de guerre en soi constituent les seules périodes durant lesquelles les forces occidentales ont la latitude transitoire d'utiliser leur supériorité militaire écrasante - sans souci de censure - pour achever des ennemis odieux.
Mais un sens gauchi de la morale, des préoccupations de relations publiques au sujet d'images télévisées morbides projetées dans les salons du monde, et l'arrogance pure et simple engendrée par une victoire rapide, ont parfois stoppé l'application complète de la puissance américaine avant que le travail ne soit terminé. La prétendue « autoroute de la mort » en 1991 n'était pas vraiment le massacre annoncé par les médias, mais la boucherie peu médiatisée de Bassorah et du Kurdistan qui l'a suivie l'était très certainement - et elle a été provoquée par la suspension des bombardements américains, qui ont permis à des milliers d'assassins irakiens de fuir et de se regrouper pour perpétrer leurs meurtres en série.
L'incapacité à annihiler les Taliban et les hommes d'Al-Qaïda acculés à Tora Bora a fait que de nombreux terroristes ont fui au Pakistan, et reviennent maintenant se frayer un chemin en Afghanistan. L'impossibilité de faire irruption dans le triangle sunnite à partir du nord dans les premiers jours de la guerre en Irak a fait que les Baasistes se sont rendus au lieu d'être tués ou battus - et qu'ils tirent maintenant sur des soldats qui les terrifiaient quelques mois plus tôt, lorsque toute l'étendue de la puissance de feu américaine avait été déployée.
Quelle leçons en tirer pour la guerre post-moderne? Avant que les caméras, les vérificateurs et l'ONU ne rappliquent, avant que les combattants terrifiés et en fuite ne renaissent en terroristes enhardis, avant que les reporters intégrés partent et que les journalistes d'investigation arrivent, et avant que l'on demande aux soldats victorieux de devenir des gardiens de la paix, des sociologues et des travailleurs humanitaires, les militaires doivent achever la destruction des forces ennemies en une minute impitoyable. Après tout, un colonel qui déchiquette un baasiste irakien en avril peut gagner une médaille, mais si en octobre il tire une balle près de la tête d'un terroriste présumé pour sauver la vie de ses hommes, il peut s'attendre à passer en cour martiale.
L'étendue des pertes
Dans l'hystérie qui a précédé la bataille en Irak, le monde reprochait à l'Amérique de redouter les pertes, d'être une brute effrayée par le syndrome des body bags. Quelle amusante accusation pour un pays qui a enduré des carnages horribles de Gettysburg à Okinawa, et qui perdait des milliers d'hommes chaque mois au Vietnam ! En vérité, c'est au contraire une Amérique opulente et sauvagement libre qui, plus que tout autre pays occidental, peut encore accepter les pertes au combat - si ses citoyens ont le sentiment que ces sacrifices en valent la peine. L'essentiel est de s'assurer ce qui constitue un concept aussi vague et semble-t-il amoral « d'en valoir la peine ».
« L'intérêt national » et « une juste cause », bien sûr, sont nécessaires pour accepter des pertes, mais souvent ces termes nébuleux ne sont pas immédiatement perceptibles aussi bien pour les soldats en campagne que pour la population au pays. Dans des guerres courtes et intenses, les manœuvres, la sensation de l'avancée et le fait que nos soldats infligent bien plus de dommages à leurs ennemis que l'inverse sont tout aussi importants. Les capitaines américains de Sherman à Patton ont compris que les Américains sont un peuple impulsif et impatient, à l'aise avec les machines et le mouvement, et lassés par l'équilibre et l'immobilité apparente. Et avec 500 chaînes de télévision, l'Internet et 50 arômes de café, ils sont bien plus impatients en 2003 qu'à l'époque de 1864 ou de 1944.
Dans les conditions de la guerre contemporaine, si les Américains sentent que pour chaque attentat-suicide subi des dizaines de Baasistes y laissent leur peau, qu'une offensive terrible est menée contre les assassins de Tikrit ou que ceux qui s'infiltrent à la frontière irako-syrienne sont bombardés, alors ils en concluent qu'il y a un début et une fin à ce conflit. En conséquence, ils considèrent que le combat est limité dans le temps et qu'il vaut le sacrifice - un jugement inconcevable lorsque les soldats sont les cibles statiques d'un ennemi insidieux qui semble n'avoir aucune base, aucun ordre de bataille et aucune distinction avec la population civile.
Les Américains ont pu accepter les pertes lorsque leurs soldats avançaient sur Bagdad, mais ils le font moins aisément lorsque ceux-ci vivent à Bagdad. Il est donc essentiel pour les militaires de trouver le moyen, dans le climat chaotique que connaît l'Irak, de donner aux Américains l'assurance qu'ils sont sur l'offensive, toujours en mouvement, et toujours en mesure de combattre leurs ennemis.
L'impossibilité de prévoir
Le bon sens veut que dans une guerre asymétrique, post-moderne, de quatrième génération, la puissance conventionnelle écrasante ne signifie pas grand chose - pas lorsqu'un lance-roquettes bon marché et quelques adolescents illettrés peuvent abattre un hélicoptère valant 6 millions de dollars piloté par des capitaines licenciés universitaires. Il est à craindre qu'un non-Occidental parasite puisse importer nos armes sans payer notre coûteux talent militaire - et néanmoins obtenir une sorte de parité, en raison de notre soin porté aux vies humains, de notre goût pour la paix ou de notre refus du terrorisme ou d'autres tactiques sordides.
Après tout, nous sommes riches et nous tenons à la vie ; nos ennemis sont pauvres et n'ont pas grand chose à perdre. C'est pourquoi Israël envisage d'échanger 300 terroristes emprisonnés contre la vie d'un seul homme d'affaires israélien. Le monde accepte qu'aucun des premiers ne soit abjectement assassiné en prison, alors que le second peut l'être et le sera probablement. Les prisonniers américains sont violés et abattus en toute impunité ; les prisonniers baasistes irakiens ne peuvent même pas être effrayés. Nous ne pouvons ni ne devons changer nos valeurs ; nous ne pouvons pas non plus changer le fait que nous utilisons la technologie et l'éducation pour protéger nos soldats pendant que nos ennemis utilisent le fondamentalisme et l'ignorance pour galvauder les leurs.
Mais les lignes de faille culturelles ne signifient pas que nous ne puissions parfois nous libérer quelque peu. Si les citoyens de Tikrit choisissent de tuer des Américains ou d'approuver ces assassinats, peut-être que le courant électrique de leur fière cité sera mystérieusement détourné vers le Kurdistan et au sud. Si la Syrie envoie des assassins pour tuer des Américains, peut-être que nos pilotes ne sauront plus très bien où commence et s'arrête sa frontière avec l'Irak. Si la France accuse publiquement les Etats-Unis, peut-être que des roquettes françaises récemment achetées et retrouvées dans des dépôts baasistes seront utilisées comme toile de fond lors de conférences de presse. Si des munitions sont saisies dans les maisons d'assassins, peut-être que ces maisons seront évacuées et, après un avertissement en bonne et due forme, réduites en tas de gravats.
Il ne s'agit pas d'illustrer notre propre imprévisibilité, mais plutôt de faire passer lentement et tranquillement le message qu'un militaire parfaitement humain et civilisé peut parfois être un peu fou. Dans cette nouvelle guerre, le pire pêché d'un militaire occidental est tout simplement d'être prévisible.
L'omniprésence de la politique
Les opérations militaires ne sont pas seulement une prolongation de la politique, elles sont elles-mêmes inséparables de la politique - à partir de l'instant où les bombes sont lâchées jusqu'au retrait final des troupes de maintien de la paix. A l'avenir, les paramètres rigides selon lesquels les Forces armées américaines pourront opérer sans une condamnation pavlovienne seront très clairs. La cause, les conditions du combat, la nature de l'ennemi - toutes ces considérations jadis essentielles le sont à présent moins que le parti menant la guerre. De plus en plus, les Démocrates semblent être des pacifistes autoproclamés et des néo-isolationnistes qui affichent leur horreur pour la guerre - et qui de ce fait obtiennent la légitimité de conduire des opérations militaires, bien qu'avec une répugnance visible.
Prenez l'opération Desert Fox de décembre 1998. Bien qu'embourbé dans un impeachment scandaleux, le Président Clinton a ordonné quatre jours de bombardements contre des installations d'armes de destruction massives présumées en Irak. Peu ont affirmé que ces bombardement visaient à détourner l'attention du public de ses difficultés politiques, et moins encore que l'absence de toute preuve d'installations d'armement détruite suggéraient l'inexistence de celles-ci. Le Président Clinton n'a pas été mis au pilori ni pour la préemption, ni pour l'unilatéralisme - bien qu'il n'ait pas demandé l'approbation du Sénat, qu'il n'ait mené aucune discussion à l'ONU, qu'il n'ait pas affirmé que Saddam nous avait attaqué en premier, et naturellement sans qu'il ne recherche une résolution multilatérale. L'OTAN et l'Europe n'avaient pas non plus été impliquées.
Le général Zinni a supervisé l'opération et, dans une conférence, il a confessé que quelque 4000 Irakiens pouvaient avoir été tués, y compris quelques civils. Il n'y a eu aucune marche pour la paix, aucun éditorial enflammé dans la presse européenne, et bien peu d'allégations républicaines que deux ans avant une élection nationale, les Etats-Unis avaient bombardé de manière inutile et cynique des installations qui n'ont pas produit avec certitude des armes, ni même été détruites. Aucun général en retraite n'a accusé le général Zinni d'avoir mené une guerre superflue et d'avoir entraîné des dommages collatéraux - ni même traité Clinton de « faucon de pacotille. » [Traduction très libre de « chicken-hawk », désignant des va-t'en-guerre présumés privés de toute expérience militaire, note du traducteur]
Le même scénario avait été joué dans les années 70 et 80. Comparez les invectives qu'a reçues Reagan pour être allé en Grenade, ainsi que Bush senior pour le Panama et le Koweït, avec la liberté donnée à Carter pour essayer d'utiliser la force dans la prise d'otages de Téhéran, ainsi que les tirs de missiles de Clinton en Afrique et les bombardements prolongés en Serbie.
A l'avenir, les Forces armées américaines doivent accepter que si on leur demande de partir en guerre sous une administration républicaine, ses problèmes de relations publiques vont poser autant de dilemmes que la campagne elle-même - parce que le New York Times, la Radio Publique Nationale, les campus, les principales chaînes télévisions et les Européens vont presque immédiatement tenter de contrer et de caricaturer les efforts de l'Amérique. Au contraire, dans notre société contemporaine thérapeutique qui prend au sérieux les morsures de lèvres, les douleurs publiques et les professions de foi utopiques, les Démocrates peuvent largement utiliser les armées comme ils le veulent - pour autant qu'ils aient l'air d'utiliser sobrement et judicieusement la force en tant que « dernier recours. »
De telles généralisations ont peu à voir avec l'histoire : aussi bien pendant la Première que la Deuxième Guerre Mondiale, les Démocrates étaient considérés comme des internationalistes engagés et les Républicains comme de vibrants isolationnistes. Ces lignes de séparation ne sont pas non plus des tendances permanentes, puisqu'il n'y a rien dans l'idéologie démocrate qui exclut intrinsèquement l'usage de la force pour une cause nécessaire.
Néanmoins, les perceptions actuelles du public et les réalités politiques vont probablement persister, puisque des idéologies populaires récentes comme le multiculturalisme et l'idéalisme social font partie intégrante du parti démocrate. Ces deux notions tendent à définir les Forces armées non pas comme une force positive, mais comme une extension de la pathologie américaine qui légitime l'oppression fondée par la globalisation, l'économie, le racisme, le sexisme et le colonialisme.
Texte original: Victor Davis Hanson, "The Paradoxes of American Military Power", National Review Online, 17.11.2003
Traduction et réécriture: Maj EMG Ludovic Monnerat
© 1998-2003 CheckPoint |