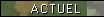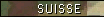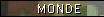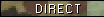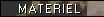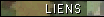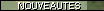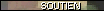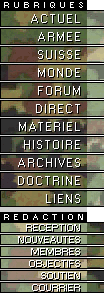








Les Marines face aux pièges de l'Irak,
ou l'histoire d'une bavure tragique
15 juin 2003

orsque la guerre en Irak sera étudiée et entrera dans l'histoire, l'attention principale se portera sur le rôle de la technologie – le bombardement de précision, les missiles de croisière et les frappes de décapitation. C'est qui était nouveau. Mais il y avait une autre facette de la guerre, et c'est celle que la plupart des combattants ont connu en Irak, même si ce n'est pas ce que les Américains ont vu à domicile : la puissance militaire brute, des humains tuant d'autres humains.
Le 3e bataillon du 4e [régiment de, note du traducteur] Marines était l'une des expressions les plus directes de cette puissance. Basé à Twentynine Palms en Californie, il est spécialisé dans la guerre désertique et compte environ 1500 soldats ; durant la guerre en Irak, il était équipé de 30 chars de combat Abrams et de 60 véhicules d'assaut blindés, appuyés par l'artillerie et l'aviation nécessaires à ses missions, sous la forme d'obusiers de 155 mm, d'hélicoptères d'attaque Cobra et de chasseurs-bombardiers.
Ce bataillon a fait presque littéralement trembler le sol lorsqu'il s'est ébranlé au nord du Koweït, commençant sa marche en s'emparant de l'aéroport de Bassorah, continuant au-delà de Nasiriyah, dans le désert et à travers une tempête de sable qui a repeint le ciel en rouge et qui, à ses pires instants, est devenue une tornade frappant les véhicules blindés comme des jouets en plastique écartés par les doigts d'un enfant. Sur la route de Bagdad, le bataillon a également livré des combats féroces mais limités à Afaq et à Diwaniya, à environ 190 km de la capitale irakienne, puis à Al Kut, à environ 160 km de celle-ci.
Bataille sur la rivière Diyala
Le 6 avril, trois jours avant la chute de Bagdad, le bataillon est arrivé au pont de Diyala, une voie d'accès au secteur sud-est de la ville. Le pont traversait la rivière Diyala, qui se jette dans le Tigre. Une fois franchi son arc de 135 mètres, le 3e bataillon n'aurait plus été qu'à 9 km du centre de la ville. Mais le pont était solidement défendu sur la rive nord à la fois par des éléments de la Garde républicaine et des forces irrégulières, et la bataille pour s'en emparer et le franchir a pris deux jours. En rétrospective, c'était un événement remarquable de la guerre, un exemple précis du type de combat brutal et rapproché qui n'a pas été montré sur les chaînes cablées [aux Etats-Unis, NDT].
Le 3e bataillon avait une stratégie cohérente dans son avance sur Bagdad : tuer chaque combattant refusant de se rendre. C'était extrêmement efficace. Cela a permis au bataillon d'avancer rapidement et de minimiser les pertes américaines. Mais cette stratégie avait un prix, et ce dernier fut payé dans le sang sur l'autre côté du pont Diyala.
Le commandant de la formation, le lieutenant-colonel Bryan McCoy, avait une allure calme qui n'a jamais semblé vaciller pendant que lui et ses soldats ont fait leur chemin à travers l'Irak. Son humeur restait la même, qu'il soit au combat, boive son café matinal ou fume un cigare ; ni le ton, ni le tempo de sa voix ne s'écartaient de sa attitude imperturbable. Peut-être son calme venait-il de l'expérience. Son père était un officier de l'armée au Vietnam, et il a servi durant deux tours de combat. McCoy est né dans le monde militaire et y a vécu toute sa vie. Ce n'était pas la première fois qu'il se battait contre des soldats irakiens ; il commandant une compagnie durant la Guerre du Golfe de 1991.
Lorsque je lui ai parlé du côté sud du pont Diyala, peu après que le bataillon y arrive au matin du 6 avril, il était d'humeur sereine. "Les choses se passent bien", a-t-il dit. "Vraiment bien." Lorsque le colonel McCoy vous disait que les choses se passaient bien, il voulait dire que ses Marines tuaient des combattants irakiens. C'est ce qu'il se passait quand nous échangions des propos aimables près du pont. Son Humvee blindé était parqué à 25 mètres de celui-ci. Si l'un des soldats de la Garde républicaine de l'autre côté avait voulu crier une insulte par-dessus la rivière, on l'aurait entendu – si le bataillon de McCoy à cet instant ne lançait pas tellement de balles, d'obus de mortier et d'artillerie qu'un cri n'aurait jamais été entendu, si jamais les Irakiens avaient le temps pour insulter quiconque avant de mourir. Le seul bruit était le rugissement de la mort.
L'objectif immédiat de McCoy était de détruire ou de repousser assez de forces adverses sur la rive nord pour lui permettre de faire traverser ses hommes et ses équipements. Il ne doutait pas de son succès. Il était assis sur le siège avant de son Humvee, avec l'écouteur d'une radio cryptée à son oreille gauche. Il avait une sorte de fierté victorieuse dans la voix que l'on entend d'un businessman ouvrant du pied la porte du clubhouse lorsqu'il a de nouveau réussi le par. Deux chars Abrams passèrent près de nous en grondant – les véhicules qui pèsent 67 tonnes la pièce ne se déplacent pas doucement – et la terre trembla, mais pas autant que sur l'autre côté de la rivière, où les obus de mortiers américains explosaient à 135 mètres. Les sombres panaches de fumée qui créaient un effet crépusculaire à midi, le verre brisé et le métal froissé sur la route, les Marines avec leurs gilets pare-éclats qui s'accroupissaient et déchargeaient leurs armes – c'était un jour pour les connaisseurs du combat rapproché, comme le colonel.
"Nous ramenons un peu ces chars pour prendre soin de ces types là-bas", expliqua-t-il, inclinant sa tête à droite, où des combattants irakiens mobiles tiraient sans succès des roquettes sur ses hommes. L'évaluation du colonel McCoy était carrée comme un Marine : "nous les tuons." Il porta son attention sur le combiné radio, pour informer son commandant de régiment. Sa voix restait calme. "Dark Side Six, Ripper Six", dit-il, en utilisant son indicatif et celui de son commandant. "Nous les tuons comme on ne le fait plus. Ils reçoivent des renforts, ces Gardes républicains, et nous les tuons dès qu'ils se montrent. On commence à être à court de mun."
Embuscade près d'Al Kut
McCoy, auquel les Marines se référaient simplement en disant "le colonel", ne succombait jamais dans sa franche description du massacre à l'équivalent militaire de l'exubérance, de l'irrationnel ou quoi que ce soit d'autre. Pour lui, comme pour les autres officiers qui avaient eu l'honneur d'un commandement au front, cette guerre n'avait rien à voir avec les cœurs, les esprits ou même la libération. Ceux-ci ne sont que des concepts informes, et non des missions claires. Pour le colonel McCoy et les autres officiers qui ont infligé de lourdes pertes aux Irakiens et n'en ont souffert que peu, cette guerre se résumait à une chose : tuer quiconque souhaitait prendre une arme pour défendre le régime de Saddam Hussein, même s'il prenait la fuite. Le colonel McCoy se référait à cela en parlant d'établir "une violente suprématie."
"Nous sommes ici jusqu'à ce que Saddam et ses acolytes soient morts", m'a-t-il dit une fois, durant sa marche sur Bagdad. "C'est fini pour nous lorsque le dernier type qui veut se battre pour Saddam a des mouches qui rampent sur ses yeux. Puis nous rentrons à la maison. C'est une tactique de choc. Sherman a dit que la guerre est synonyme de cruauté. Il n'y a aucun sens à essayer de la raffiner. Plus elle est cruelle, plus vite c'est fini."
Lorsque j'ai suggéré au colonel McCoy un matin que les civils irakiens pourraient ne pas apprécier la manière avec laquelle ses Marines saluaient les indigènes, avec les canons de leurs armes pointés, il ne s'est fendu d'aucune excuse. "Ils n'ont pas besoin de nous aimer", a-t-il dit. "Aimer n'a rien à voir avec cela. On ne peut pas faire qu'ils nous aiment. Je ne peux pas faire qu'ils m'aiment. Tout ce que nous pouvons faire est qu'ils nous respectent et nous assurer qu'ils savent que nous sommes ici pour eux. Faire qu'ils nous aiment – les Yankees veulent toujours être aimés, mais cela ne marche pas toujours ainsi."
Bien que le combat était inégal, les Marines ne sont pas parvenus indemnes au pont Diyala. Le 3 avril, trois jours avant la bataille pour le pont, le 3e bataillon est entré dans la ville d'Al Kut. C'était une incursion destinée à montrer que, comme l'a décrit le colonel McCoy, il y avait de nouveaux "mâles dominants" dans le pays. L'attaque commença à l'aube par un barrage d'artillerie qui excitait les Marines près de mon véhicule. Ils criaient "bam ! bam !" à chaque fois qu'un obus était tiré. Les chars ouvraient la marche vers la ville, et alors que j'étais resté un kilomètre derrière à un poste de secours sanitaire, les bruits de la bataille ont éclaté, des mortiers et des mitrailleuses accompagnés comme toujours par les éléments visuels de la guerre – des panaches de fumée qui auraient fait rêver un pyromane.
Après une demi-heure de combat, un Humvee émergea de la ville et stoppa vers le poste de secours. Un Marine, dont le corps était flasque comme une poupée de chiffe, fut extrait du véhicule et déposé sur un brancard. Un médecin des Marines et des infirmiers l'entouraient. Ses habits furent arrachés et des aiguilles ainsi que des sondes furent placés dans et sur son corps, pendant que le dialogue de la médecine de guerre avait débuté parmi l'équipe, dont chacun avait passé son M-16 en bandoulière arrière alors qu'ils tentaient de sauver la vie de leur camarade.
"A gauche en bas de l'abdomen."
"Il a besoin d'une intervention d'urgence."
"Remue tes orteils pour moi."
"Aow, aow."
"Il a besoin d'une évacuation sanitaire, tout de suite."
"Iode."
"Je ne sens plus mes bras."
"Continue de parler, Evnin."
Son nom était Mark Evnin. Il était caporal, un tireur d'élite qui se trouvait dans l'un des véhicules de tête entrant dans Al Kut. Des combattants irakiens attendaient en embuscade et avaient tiré les premiers ; l'un d'entre eux l'a touché.
"Continue de nous parler. D'où viens-tu ?"
"Remon", murmura-t-il.
"D'où ? D'où viens-tu ?"
"Verrrmon."
Evnin n'allait pas bien. L'aumônier du bataillon, Bob Grove, se pencha sur lui, et parce qu'il savait qu'Evnin était juif, il sortit de sa poche une feuille avec des instructions pour des "sacrements juifs d'urgence." Grove lut le Sh'ma, qui commence par "Ecoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu." Puis il commença à lire le 23e psaume, lorsque Evnin lui dit : "Aumônier, je ne vais pas mourir."
Un Chinook atterrit à 45 mètres de là. Le brancard d'Evnin fut soulevé de l'asphalte et précipité dans l'hélicoptère. Peu après le décollage, il sombra dans le coma et mourut.
Face aux attentats-suicides
Le colonel McCoy était juste à quelques mètres de l'endroit où le caporal Evnin fut mortellement blessé. "Je l'ai vu tomber", m'a-t-il ensuite dit. "Ce combat a duré environ 9 secondes. Nous avions une vague d'environ 15 hommes qui attaquait les chars. Ils ont tous été fauchés. Ils ont frappé les premiers. Ils ont eu l'un d'entre nous, mais nous avons eu chacun d'entre eux."
Le caporal Evnin fut le premier tué au combat du bataillon, mais il n'était certainement par le seul Marine à mourir en Irak. Les hommes du 3e bataillon suivaient de près les nouvelles des pertes de Marines au combat. Le jour avant leur arrivée au pont Diyala, un char des Marines fut détruit par un camion bourré d'explosifs qui roula à sa hauteur et fut mis à feu par son conducteur. C'était la concrétisation d'une des pires craintes des Marines : les attentats-suicides.
McCoy restait concentré ; il m'a dit que sa mission, tuer des combattants irakiens, n'avait pas changé. "Je n'ai pas luxe de laisser mes émotions guider mes décisions. Cela obscurcirait mes décisions, et j'en prendrais de mauvaises si je me soumettais à cela. Je dois tout considérer de manière très clinique." Il a réagi de manière tactique à l'attentat-suicide : un nouveau danger avait émergé, et ses soldats durent élever leur niveau d'alerte face à la menace posée par les véhicules civils.
Mais la mort de leurs camarades a profondément affecté les fantassins, et lorsque le bataillon arriva au pont Diyala, chacun était prêt à tuer. "Il y a un changement d'attitude muet", m'a dit McCoy quelques jours avant le pont. "Leur sang est en train de bouillir."
La bataille pour le pont Diyala a duré deux jours. L'un des piliers principaux du pont avait été lourdement endommagé, et les véhicules blindés ne pouvaient pas le franchir. Ainsi, après le premier jour de combat du 6 avril, le bataillon s'enterra sur la rive sud pour la nuit, afin d'avoir le temps de planifier un assaut d'infanterie sur la travée le matin suivant.
Ce matin-là, le bataillon délivra une autre salve de puissants barrages d'artillerie pour réduire l'opposition sur le côté nord de la rivière. Durant le combat, deux Marines supplémentaires perdirent la vie lorsqu'un obus d'artillerie frappa leur véhicule blindé au sud du pont [en raison d'un tir court, NDT]. Finalement, le bataillon tua la plupart des combattants de la Garde républicaine, ou du moins les repoussa de leurs positions retranchées sur la rive nord, et McCoy décida qu'il était temps de tenter un franchissement.
Les hommes du 3e bataillon se déplaçaient sur le pont Diyala en étant "débarqués", c'est-à-dire à pied. C'était un tableau du Vietnam, ou même de la Seconde guerre mondiale : des fantassins courant et vidant leurs armes devant eux. C'était, comme McCoy l'a décrit, "de la guerre en col bleu."
Lorsque les Marines ont atteint la rive nord, ils se retrouvés au sein d'un environnement semi-urbain avec des commerces à un étage, des maisons à deux étages, quelques dizaines de palmiers et des tonnes de poussière. Une autoroute étroite s'éloignait du pont en direction de Bagdad. Immédiatement, ils furent pris sous le feu – quelques balles sporadiques et parfois une roquette, tirés principalement d'un bosquet de palmiers sur le côté est de la route menant à la capitale.
Le colonel McCoy plaça son poste de commandement avancé – en fait, son radio et lui-même – à côté d'une maison près du pont. Les Marines se déployèrent dans le bosquet de palmiers, pendant que d'autres remontaient la route au nord, en allant d'une maison à l'autre. Les unités de pointe établirent des positions de snipers et de mitrailleuses quelques centaines de mètres plus loin sur la route ; devant eux, les obus de mortier et d'artillerie tirés par des unités situées près de la position du colonel McCoy ou derrière pleuvaient lourdement.
L'un des sergents de McCoy courut vers lui et lui dit que des renforts irakiens venaient juste d'arriver. "Un véhicule technique a largué quelques [censuré] là-bas", dit-il en désignant la route.
"Est-ce que vous l'avez eu ?", demanda le colonel McCoy.
"Ouais."
"Les [censuré] ?"
"Certains d'entre eux. D'autres se sont enfuis."
"Les gars s'en sortent bien", dit le colonel quelques instants plus tard. "La force brute va l'emporter aujourd'hui." Il écouta sa radio. "Des kamikazes en route pour le pont ?", demanda-t-il. "On va les défoncer."
Puis, un par un, une demi-douzaine de véhicules apparurent sur la route, séparément, et les Marines se préparèrent à les défoncer.
Un convoi plein de civils
La confusion est le propre de la bataille. Si une unité militaire est bien entraînée et bien conduite, la confusion peut être minimisée, mais jamais complètement éliminée. Les décisions prises en une fraction de seconde – tirer ou ne pas tirer, aller à gauche ou à droite, se mettre à couvert derrière une maison ou dans un fossé, que l'ennemi soit devant à 200 mètres ou à 400 mètres – le sont souvent sur la base d'informations fragmentaires et contradictoires par des hommes qui sont privés de sommeil ou fonctionnent par l'adrénaline ; par des hommes qui ont peur pour leur vie, pour celles des civils qui les entourent ou les deux ; par des hommes qui se fient à des instincts devant les garder en vie et ne pas leur faire commettre des actions qu'ils regretteront jusque dans leurs tombes. Lorsque des soldats prennent des décisions en une fraction de seconde, ils en ignorent le résultat.
La situation était encore plus compliquée sur le côté du pont Diyala, parce que les restes de la résistance irakienne recouraient à des tactiques de guérilla. Les Irakiens qui tiraient encore sur les Marines ne portaient pas d'uniforme. Ils tiraient quelques coups depuis une fenêtre, lâchaient leurs armes, s'enfuyaient comme s'ils étaient des civils, puis allaient à un endroit où ils avaient caché des armes afin de tirer à nouveau avec celles-ci.
Dans le chaos de la bataille, McCoy était comme toujours placide mais concentré. Une fumée noire passait au-dessus et à travers les rues ; des centaines de Marines se glissaient sur leurs ventres ou courant courbés, se ruant aussi vite qu'ils le pouvaient avec leur équipement de combat d'un palmier à l'autre ou d'une maison à l'autre. De tous côtés, on entendait un bruit de fusillade, un orchestre de sons – le "pop-pop" des fusils d'assaut, le "boom-boom" des mitrailleuses lourdes, le "thump" des mortiers. L'harmonie avait un jour de congé. Il y a eu une éruption soudaine de quelques coups, puis un crescendo par lequel il semblait que chaque Marine au voisinage tirait avec son arme sur un ennemi en grande partie invisible ; et ensuite cela cessa brièvement.
L'essentiel du feu émanait des forces de McCoy, non des Irakiens. Certaines Marines bifurquaient plus à l'est, au-delà du bosquet de palmiers. D'autres avançaient devant, directement sur la route, essayant de "tenir bon" sur une ligne de front et d'établir un périmètre défensif dans lequel les combattants irakiens ne pourraient pénétrer.
Le plan stipulait que les tireurs d'élite disposés le long de la route tirent des coups de semonce plusieurs centaines de mètres devant la route sur tout véhicule approchant. Lorsque la demi-douzaine de véhicules approcha, plusieurs coups furent tirés sur le sol devant les voitures ; d'autres furent tirés, avec une grande précision, dans leurs pneus ou dans leurs blocs moteur. Les tireurs d'élites des Marines sont précis. Les coups de semonce étaient destinés soit à simplement mettre en panne un véhicule en détruisant le moteur ou les pneus, soit à envoyer le message que les voitures devraient stopper ou rebrousser chemin, ou que les passagers devraient sortir et avancer vers les Marines.
Mais certains des véhicules n'ont pas été entièrement mis hors service par les tireurs d'élite, et ils continuèrent à avancer. Lorsque cela se produisit, les Marines criblèrent les véhicules de balles jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent. Aucune voiture piégée n'aurait un membre du 3e bataillon.
Les véhicules, comme il devint clair par la suite, étaient pleins de civils irakiens. Ces derniers tentaient apparemment d'échapper aux obus américains qui atterrissaient derrière eux, plus loin sur la route, et de fuir Bagdad ; la route sur laquelle ils se trouvaient était l'une des principales pour sortir de la ville. Les civils ne pouvaient probablement pas voir les Marines, qui portaient des tenues camouflées et avaient pris des positions au sol et sur les toits de manière à ce que des combattants adverses ne puissent les apercevoir. Ce que les civils ont probablement vu devant eux, c'était une route libre ; aucun véhicule militaire américain n'avait alors pu traverser le pont endommagé. Dans le chaos, des civils roulaient vers un bataillon de Marines qui avait juste perdu deux des siens au combat le matin et à qui l'on avait dit que des kamikazes se dirigeaient vers eux.
Deux combattants dans le convoi
L'un après l'autre, les civils furent tués. A plusieurs centaines de mètres des positions avancées des Marines, un minivan bleu fut pris pour cible ; trois personnes perdirent la vie. Un vieil homme, marchant avec une canne sur le bord de la route, fut touché et tué. On ignore ce qu'il faisait là ; peut-être était-il désorienté et effrayé, et il essayait juste de s'éloigner de la ville. Plusieurs autres véhicules furent touchés ; sur un segment d'environ 550 mètres, près d'une demi-douzaine de véhicules ont été stoppés par le feu. Lorsque ce dernier cessa, il y avait près d'une douzaine de cadavres, dont tous sauf deux n'avait aucun habit militaire ou aucune arme.
Deux journalistes qui étaient devant moi, plus loin sur la route, ont dit qu'un commandant de compagnie a ordonné à ses hommes de ne pas tirer jusqu'à ce que les tireurs d'élite lâchent quelques coups, pour essayer de mettre en panne les véhicules sans tuer les passagers. "Laissez les snipers s'occuper des véhicules civils", a dit le commandant. Mais dès que le sniper le plus proche a tiré ses premiers coups de semonce, d'autres Marines ont apparemment ouvert le feu avec leur M-16 ou leur mitrailleuse.
Deux autres journalistes qui étaient avec un autre groupe de Marines le long de la route également impliqué dans la fusillade. Tous deux ont dit qu'un chef de groupe, après la fin des tirs, s'est exclamé : "Mes hommes n'ont montré aucune pitié. Excellent." [Etant donné la distance jusqu'à leurs cibles, il est cependant impossible que ceux-ci aient pu être identifiés comme des non-combattants à cet instant, NDT]
La bataille a duré jusqu'au cours de l'après-midi, et le bataillon a campé pour la nuit sur la rive nord. Le matin suivant, le 8 avril, je suis descendu le long de la route. J'ai compté au moins 6 véhicules qui avaient été touchés. La plupart contenaient des cadavres ou avaient des cadavres près d'eux. Le van bleu, un Kia, avaient plus de 20 trous de balles dans son pare-brise. Deux corps étaient affalés sur les sièges avant ; c'étaient des hommes en habit de ville qui n'avaient aucune arme visible. Sur le siège arrière, une femme dans un tchador était tombée sur le plancher ; elle était également morte. Il n'y avait aucun bagage visible dans le van – ni valise, ni bombe.
Deux des passagers du van avaient survécu à la fusillade ; l'une d'entre eux, Eman Ashamnery, avait pris une balle dans un orteil. Elle s'était évanouie et avait passé la nuit dans le véhicule. Lorsqu'elle s'est éveillée le matin, elle a été emmenée par des Marines pour être traitée par leur équipe médicale.
Ashamnery m'a dit que leur maison à Bagdad avait été bombardée, et qu'elle essayait de fuir la ville avec sa sœur, qui était la femme morte que j'avais vue sur le siège arrière du van. Elle a dit qu'elle n'avait pas entendu de coup de semonce – ce qui ne signifie pas qu'aucun n'ait été tiré. En fait, il aurait été difficile, en particulier pour des civils inaccoutumés aux sons de la guerre, de savoir qu'un coup de semonce leur était adressé, ou de savoir d'où il venait, ou même de réagir de manière appropriée.
Ashamnery, qui m'a parlé par l'intermédiaire d'un interprète des Marines, était assise à côté d'une autre femme, qui donna le nom de Bakis Obeid et a dit qu'elle était dans l'un des autres véhicules tués. Elle a affirmé que son fils et son mari avaient été tués.
Il y avait d'autres survivants. Quelques mètres sur la route après le van Kia, trois hommes creusaient une tombe. L'un d'eux a dit se nommer Sabah Hassan et affirmait être un cuisinier à l'hôtel Al Rashid, qui se trouve au centre de Bagdad et, à une époque plus pacifique, était la résidence des journalistes étrangers. Hassan a dit qu'il fuyait la ville et roulait dans une berline avec trois autres hommes lorsqu'ils ont été pris sous le feu, apparemment des Marines. Un passager de sa voiture a été tué. Je lui ai demandé ce qu'il ressentait.
"Que puis-je dire ?", a-t-il répondu. "J'ai peur de dire quoi que ce soit. J'ignore de quoi l'avenir sera l'avenir fait. S'il-vous-plaît." Il replongea sa pelle dans la terre et continua ses travaux d'excavation.
Non loin de ces hommes, je suis tombé sur le corps du vieil homme avec sa canne. Il avait une blessure énorme à l'arrière de sa tête. Il est mort sur le dos, regardant le ciel, et son corps était couvert de mouche. Sa canne faite d'aluminium reposait dans sa main droite.
Quelques mètres plus loin, un pick-up Toyota était figé sur le côté de la route avec plus de 30 impacts de balles dans son pare-brise. Le conducteur, qui portait un habit militaire vert, était mort, la tête rejetée en arrière, légèrement sur la gauche. Tout près, le corps d'un autre homme gisait au sol, couché sur le ventre ; un holster de pistolet était attaché à l'arrière de sa ceinture. Un fusil d'assaut AK-47 se trouvait tout près, sur le sable. C'étaient les seuls combattants, ou combattants apparents, que j'ai vus sur la route ou dans les bâtiments voisins.
La guerre sanglante et cruelle
Alors que je prenais des notes, plusieurs Marines approchèrent et regardèrent à l'intérieur du van bleu. "J'aurais bien voulu être ici", a dit l'un d'entre eux. En d'autres termes, il souhaitait avoir participé à la bataille. "Les Marines se sont lâchés", a dit un autre. "Mieux vaut ça que l'inverse."
Un journaliste arriva et déclara que les civils n'auraient pas dû être abattus. Il y eut un silence, et quand le journaliste s'est éloigné, un troisième Marine, le caporal-chef Santiago Ventura, commença à parler avec colère. "Comment pouvez-vous dire qui est qui ?", rétorqua le caporal Ventura. Il parla abruptement, comme s'il essayait de contenir sa fureur. "Vous avez un soldat dans une voiture avec un AK-47 et des civils dans la voiture suivante. Comment savoir ? Vous ne pouvez pas savoir."
Il fit une pause. Puis il continua, toujours vexé par la suggestions que les tirs n'étaient pas corrects. "L'un de ces vans a détruit un de nos chars. Voiture piégée. Lorsque nous leur disons qu'ils doivent s'arrêter, ils doivent s'arrêter", a-t-il dit en se référant aux civils. "Nous devons nous soucier de notre sécurité. Nous avons largué des tracts sur ces gens il y a de cela des semaines, et nous leur avons dit de quitter la ville. Vous ne pouvez pas reprocher aux Marines ce qui s'est passé. C'est des conneries. Qu'est-ce que l'on peut faire dans un taxi au milieu d'une zone de guerre ?"
"La moitié d'entre eux à l'air de civils", a-t-il poursuivi en parlant des forces irrégulières. "Je veux dire, j'ai de la sympathie, et cela me brise le cœur, mais vous ne pouvez dire qui est qui. Nous avons fait plus qu'assez pour aider ces gens. Je ne pense pas avoir jamais lu quelque chose au sujet d'une guerre où des gens innocents ne meurent pas. Des gens innocents meurent. Il n'y a rien que nous puissions faire."
Deux jours plus tard, le 3e bataillon est arrivé à l'hôtel Palestine au centre de Bagdad, les premiers Marines à atteindre le cœur de la ville. Ils ont franchi la distance depuis la frontière koweïtienne en 22 jours. Lorsque les Marines ont pris des positions défensives autour, j'ai remarqué un tireur d'élite avec lequel j'avais fait connaissance les semaines passées. Il était accroupi au sol dans le square Firdos, devant l'hôtel, surveillant les bâtiments avoisinants à travers la lunette de son fusil et recherchant des snipers ennemis. A environ 140 mètres, à l'autre bout du square, l'un des véhicules blindés du bataillon était en train de passer une chaîne de métal autour de la statue de Saddam Hussein afin de l'abattre au sol.
Bien que ce soit un instant de triomphe, je pensais toujours aux civils tués au pont Diyala, et j'ai dit au sniper avoir entendu qu'il était l'un des hommes à avoir tiré à cette occasion. Il hocha de la tête, et je n'ai pas eu besoin de lui demander autre chose, car il a commencé à en parler. Il était clair que l'affaire du pont lui pesait aussi sur l'esprit. Il a déclaré que pendant la bataille, il a tiré dans le bloc moteur de l'un des véhicules, mais celui-ci a continué d'avancer. Pour lui, c'était la preuve que la personne derrière le volant était déterminée à avancer et à faire des dégâts.
J'ai dit qu'un conducteur civil pourrait ne pas savoir que faire lorsqu'une balle heurte son véhicule, et pourrait appuyer le champignon de peur ou de confusion. "C'est facile d'être un quarterback du lundi matin le lundi matin [autrement dit, tout est toujours plus simple après, NDT]", a-t-il répondu. "Mais nous avons fait tout ce que nous pouvions pour éviter des pertes civiles."
Lorsque j'ai visité le secteur de feu sur la route du pont Diyala, le matin après la bataille, j'ai remarqué que les voitures détruites étaient à plusieurs centaines de mètres des positions des Marines qui ont tiré sur elles. Les Marines auraient pu attendre un peu plus longtemps avant de tirer, et s'ils l'avaient fait, peut-être que les voitures se seraient arrêtées, ou peut-être que les Marines auraient déterminé qu'elles contenaient des civils [une supposition pour le moins discutable. De plus, d'après la description faite par le reporter, il faut souligner qu'attendre que les voitures passent les positions avancées des tireurs d'élite aurait mis en danger ceux-ci, aussi bien par l'hypothèse d'une voiture piégée que par la zone dangereuse des balles de leurs camarades, NDT].
Le tireur d'élite savait cela. Il savait que quelque chose de tragique s'est produit au pont. De sorte que quand nous avons discuté à Bagdad, il a cessé de défendre les actions des Marines et a commencé de décrire leur intention. Lui et ses camarades, a-t-il dit, n'étaient pas venu en Irak pour cribler de balles des femmes et des hommes âgés qui essayaient juste de se mettre en lieu sûr.
Les dommages collatéraux sont bien plus faciles à supporter pour ceux qui en sont responsables à distance – du cockpit d'un bombardier B-1, du centre de commandement d'un destroyer de la Navy ou des positions de l'artillerie. Ces guerriers ne voient pas les visages des mères et des pères qu'ils ont tués. Il ne voient pas le sang, n'entendent pas les cris et ne vivent pas avec ces souvenirs pour le restant de leurs vies. Les fantassins endurent cela. Le 3e bataillon a accompli sa mission d'infliger un désastre militaire au régime de Saddam Hussein ; la statue de celui-ci est tombée juste quelques minutes après que j'aie parlé avec le tireur d'élite. Mais les hommes du 3e bataillon ne pouvaient pas être aussi joyeux que les officiers à l'arrière, les généraux au Qatar et les politiciens à Washington.
Les civils qui ont été tués – un nombre précis n'est pas disponible et ne le sera probablement jamais – au pont Diyala ont payé le prix ultime. Mais un prix a été également payé par les hommes qui sont responsables de leur mort. Pour ces hommes, ce n'était pas une guerre propre faite de bombes intelligentes et de frappes chirurgicales. C'était la guerre comme elle l'a toujours été, la guerre à courte portée, la guerre comme Sherman l'a décrite – sanglante et cruelle.
Texte original: Peter Maass, "Good Kills", New York Times Magazine, 20.4.03
Traduction et réécriture: Maj EMG Ludovic Monnerat
© 1998-2003 CheckPoint |