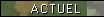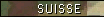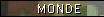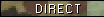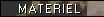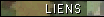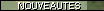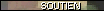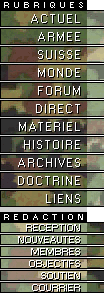










Matière, psyché, morale et savoir :
le quadrant de la puissance
17 septembre 2005

omprendre la guerre, c’est avant tout comprendre ceux qui la font. Pourquoi les hommes en viennent-ils à se battre ? Comment s’exercent la violence, la coercition et la contrainte ? Quels sont les véritables rapports de force dans les conflits contemporains ? Voilà les questions auxquelles le modèle développé au fil de cet article tente de répondre.
Les déconvenues des armées dans les conflits de basse intensité ont pour cause principale leur incapacité à cerner les conditions de leur engagement, et notamment à s’écarter des schémas hérités de la guerre totale. La tendance des militaires à privilégier les facteurs matériels au détriment des facteurs immatériels, encore renforcée par la mécanisation et l’informatisation, réduit leur aptitude à maîtriser la violence par l’exercice d’une coercition mesurée. A l’inverse, le terrorisme contemporain exploite la couverture médiatique en continu pour obtenir des effets psychologiques totalement disproportionnés, alors que les organisations non gouvernementales utilisent leur posture éthique pour mieux influer sur les opérations militaires et les armes qu’elles emploient. De toute évidence, les rapports de force ne peuvent plus être résumés par la taille ou le nombre.
L’évolution de la situation internationale souligne l’urgence que revêt aujourd’hui un tel changement de perspective. Comment expliquer que la guérilla irakienne n’ait pas réussi à retourner l’opinion publique américaine malgré la mort au combat de plus de 1800 soldats, alors qu’il a suffi 10 ans plus tôt de 18 morts pour précipiter le retrait de Somalie ? Pourquoi les Palestiniens n’ont-ils pas réussi à diviser la société israélienne depuis septembre 2000, au contraire de la première Intifada ? Pour quelles raisons les attentats du 11 septembre ont-ils uni la population américaine autour de leur gouvernement, alors que ceux du 11 mars n’ont pas eu le même effet en Espagne ? Toutes ces questions mettent en jeu des forces et des règles qui sont celles de l’homme dans son activité belligérante, réelle ou potentielle. C’est donc celle-ci qu’il s’agit d’étudier.
Pouvoir, vouloir, devoir et savoir
Prenons un cas tiré de l’histoire militaire suisse pour illustrer notre démarche, et transportons-nous par la pensée dans le défilé de Morgarten, près de Schwyz, le 15 novembre 1315. La toute jeune Confédération helvétique, formée le 1er août 1291 par des paysans attachés à leur indépendance et revendicant la liberté d’élire leurs propres dirigeants, voyait alors son existence menacée par le Duc Léopold de Habsbourg, dont la Maison allait devenir la plus puissante d’Europe. Parti dans une expédition punitive avec tous ses vassaux vêtus de plus beaux atours, afin de mater ces rebelles dans une démonstration de force éclatante, le Duc est tombé dans une embuscade soigneusement préparée qui a coûté la vie à la grande majorité des 2000 chevaliers et 500 gens de pied qui l’accompagnaient.
Cette première grande victoire en Europe d’hommes libres contre des nobles en armes va cependant au-delà de l’affrontement factuel, et pose plusieurs questions d’importance. Pourquoi les Suisses étaient-ils prêts à se battre contre Léopold de Habsbourg et sa troupe, qui formait l’archétype des armées professionnelles de l’époque, alors jugées invincibles ? Essentiellement pour défendre leur société rurale et leur conception de la liberté contre l’ambition et l’impôt de la maison autrichienne, mais également parce qu’ils avaient le goût du combat et que se battre était le devoir de chaque homme valide. A l’inverse, les nobles entourant le Duc étaient mus par l’intérêt de leur caste et par la loyauté envers leur suzerain, dans le cadre d’une vision féodale qui leur conférait l’apanage des armes. Les enjeux étaient donc différents.
Ce jour-là, les Suisses ont remporté un succès éclatant au cours d’une bataille dont Léopold n’a échappé que de justesse. A cette occasion, ils ont démontré l’efficacité de leurs hallebardes en massacrant les chevaliers en armure, n’éprouvant aucune pitié pour un envahisseur pris au piège d’une embuscade rendue possible par l’avertissement d’un espion – ou d’un traître. Pour leur part, dès que les troncs et rochers lancés par les Suisses ont dévalé la pente et affolé leurs chevaux, les vassaux des Habsbourg ont promptement reflué et tenté de prendre la fuite, chacun pour soi et en écrasant leurs suivants, surpris d’être attaqués et sans défense dans un défilé censé constituer le point faible des Helvètes. Les ressources de chaque camp, matérielles ou non, étaient donc aussi différentes.
Le choix d’une embuscade contre le Duc de Habsbourg était avant tout dicté par le terrain, puisque Morgarten était le seul secteur près de Schwytz qui n’avait pas encore été fortifié ; les Suisses ont prouvé par la suite qu’ils ne craignaient pas le combat frontal contre la cavalerie. Cependant, si tous les combattants croyaient à la bataille décisive, ils ont également tenté d’utiliser d’autres moyens : l’économie, avec le blocage du marché de Lucerne et l’arrêt du transit par le Gotthard, qui constituait déjà un itinéraire majeur du commerce nord-sud ; la religion, avec l’excommunication de l’évêque de Constance ensuite annulée par l’archevêque de Mayence ; ou encore le droit, avec les procès et les arbitrages impériaux sur les disputes principales, comme le territoire d’Einsiedeln ou la suzeraineté des Habsbourg. Les méthodes employées, là encore, étaient donc différentes.
Cet exemple résumé reprend la distinction établie par Clausewitz entre les fins, les moyens et les voies, qui facilite l’appréhension de chaque belligérant. Les enjeux de la bataille de Morgarten expliquent ainsi son caractère sanglant : les Suisses ont massacré leurs ennemis parce que la survie de la toute jeune Confédération helvétique exigeait la destruction d’une classe féodale majoritairement antagoniste. De même, leurs ressources limitées expliquent la méthode choisie : la connaissance du terrain et des intentions ennemies ainsi que la volonté de combattre à mort, c’est-à-dire la supériorité cognitive et psychologique, ont permis aux Suisses de contrebalancer leur infériorité physique et morale – obligés qu’ils étaient de se battre à 1 contre 2 et dans l’opprobre des autorités religieuses – par une surprise autorisant une bataille brève et décisive.
Voilà, illustrée en quelques mots, l’articulation fondamentale qui forme le cœur de cet approche : la matière, la psyché, la morale et le savoir forment le quadrant de la puissance, les quatre domaines dans lesquels s’inscrivent les guerres humaines. Chaque acteur d’un conflit est ainsi caractérisé par des enjeux, des ressources et des méthodes dont la nature est physique, psychologique, éthique et/ou cognitive. Montrer pourquoi et comment les hommes se battent revient à se plonger dans le tréfonds de leur être, à tenter de systématiser les moyens, les pulsions, les impératifs et les concepts qui façonnent leur puissance et qu’ils emploient pour l’exprimer. Le modèle qui en résulte doit dès lors s’appliquer à toutes les formes d’affrontements et à tous les types d’acteurs, sans distinction de lieux et d’époques.
Le quadrant de la puissance
Par matière, il faut entendre la dimension physique du réel, le domaine matériel où se manifestent les éléments tangibles et visibles des belligérants : les êtres vivants, les armes, les équipements, les vivres, et bien entendu les valeurs marchandes pouvant assurer leur disponibilité. Les facteurs physiques déterminent la capacité d’agir, c’est-à-dire la possibilité matérielle de déployer des moyens et de les utiliser, ainsi que les limites qui l’entravent. La facilité de leur numérisation et de leur intégration spatio-temporelle a jusqu’ici conféré aux facteurs physiques la prédominance dans l’étude des conflits, de même qu’une place centrale – et parfois exclusive – dans les doctrines militaires. Ils ne recouvrent néanmoins qu’une partie de la puissance, et il est ainsi impossible d’expliquer le déroulement de Morgarten en prenant uniquement en compte le nombre d’hommes ou les armes employées.
De fait, l’histoire rapporte maints exemples de forces ou de nations matériellement supérieures et néanmoins défaites, à commencer par le récit biblique de David contre Goliath, et ceci s’explique principalement par deux raisons. D’une part, le nombre et la force brute ne fournissent qu’une puissance potentielle, et non une puissance réelle dans l’espace et dans le temps ; c’est une faiblesse des grandes organisations qui est exploitée dans les opérations spéciales, où des petits contingents hautement entraînés et préparés obtiennent une supériorité relative assurant la réussite de leur mission. D’autre part, la puissance n’est tout simplement pas qu’une affaire de force physique ou mécanique, et celle-ci peut même générer une faiblesse susceptible d’être exploitée ; les facteurs autres que la matière doivent également être pris en compte.
Par psyché, il faut entendre la dimension psychologique des acteurs, l’ensemble des activités mentales conscientes ou inconscientes qui fondent leurs émotions : les pulsions, les désirs, les affects, les sensations et les sentiments, avec en filigrane toute la palette des relations humaines. Les facteurs psychologiques déterminent la volonté d’agir, c’est-à-dire la possibilité émotionnelle de faire usage de ses capacités, ainsi que les inhibitions qui s’y opposent. Le courage, la confiance et la camaraderie, mais aussi la haine et le mépris sont des ressources périssables et limitées qui ont une influence déterminante sur la puissance effective des hommes et des armes. A Morgarten, l’assaut farouche des Suisses devait beaucoup à une volonté patiemment cultivée par l’exercice des armes et multipliée par la haine de l’envahisseur.
L’importance considérable des facteurs psychologiques dans tous les conflits depuis l’Antiquité n’a pas empêché le retard de leur intégration dans les rapports de forces, en dépit de quelques doctrines visant à les idéaliser pour mieux compenser l’infériorité matérielle. Pourtant, l’expérience quotidienne montre que les traits de caractère déterminent largement la combativité, l’amour-propre et l’altruisme des hommes, alors que l’entraînement des formations contribue directement à développer leur esprit de corps et ainsi raffermir leur cohésion. Dans la mesure où les unités ont une puissance supérieure à la simple addition des soldats qui les composent, la psyché forge le lien qui unit ceux-ci : la disposition à privilégier le collectif à l’individuel, et donc à risquer sa vie pour autrui.
Par morale, il faut entendre la dimension éthique des acteurs, la somme des impératifs qui forment leur jugement à propos d’actes réels ou potentiels : les lois, les règles, les préceptes, la religion, les valeurs, les coutumes et les missions, et donc l’héritage pratique de la culture. Les facteurs éthiques déterminent la légitimité à agir, c’est-à-dire la possibilité morale – ou la nécessité – d’exercer sa volonté, ainsi que les interdits qui l’enserrent. Leur existence a durablement façonné les conflits par des principes et des codes, tacites ou non, liant l’honneur des combattants à leur comportement et formant la base de la culture militaire et du droit international. La morale avait également cours à Morgarten : si les Suisses n’ont fait aucun prisonnier et ainsi violé les usages de l’époque, les premières attaques ont été lancées par une bande d’exclus et de bannis tentant de se réhabiliter.
Les facteurs éthiques ont gagné en importance avec l’avènement des démocraties modernes, reproduisant ainsi certaines réactions de la Grèce antique : alors que 10 généraux athéniens vainqueurs ont été condamnés à mort pour n’avoir pas fait récupérer les cadavres de leurs hommes tombés au combat en mer, en 406 avant J.-C., un général brillant comme Patton a failli voir sa carrière s’achever en 1943 suite à la campagne de presse déclenchée par quelques gifles distribuées à des soldats, alors même que ses manœuvres audacieuses ont économisé les vies par milliers en France l’année suivante. Il faudra cependant attendre la généralisation de la couverture télévisée, et donc l’irruption des combats dans le salon des citoyens, pour que la morale devienne un levier à part entière, en couvrant d’opprobre les hommes qui ont violé les valeurs de leur société, en imposant des limites toujours plus strictes à l’emploi des armes, ou au contraire en incitant à leur usage pour répondre à une urgence.
Par savoir, enfin, il faut entendre la dimension cognitive des acteurs, l’ensemble des connaissances acquises par l’étude, l’observation, l’apprentissage et l’expérience : les idées, les concepts, les doctrines, les certitudes, les explications et les interprétations extraites de la masse des informations disponibles. Les facteurs cognitifs déterminent l’opportunité d’agir, c’est-à-dire la possibilité de déclencher une action opportune dans le temps, dans l’espace et dans sa modalité. Leur mise en pratique ne date pas d’hier : le réseau d’espionnage et les complicités des Suisses ont ainsi constitué l’élément déterminant de la surprise de Morgarten, où les vassaux des Habsbourg croyaient le défilé non défendu ; de même, la fuite du Duc a été rendue possible par le fait que l’un de ses amis connaissait un sentier longeant le lac d’Aegeri et évitant le piège helvétique.
Pourtant, le rôle de la connaissance est aujourd’hui encore sous-estimé, précisément parce que le concept occidental du combat est lié à l’idée d’un choc frontal, délibéré et décisif. Si les services de renseignements sont largement considérés comme la première ligne de défense d’un État, l’éducation peine encore à être reconnue comme la base de sa puissance. Le processus décisionnel de chaque organisation dépend en premier lieu de sa faculté à exploiter rationnellement la masse d’informations disponibles et à en tirer un savoir libéré de la passion ou de l’idéologie ; ne pas le faire revient à s’abandonner aux influences cognitives d’autrui, à accepter sans même en prendre conscience des concepts et des idées potentiellement nuisibles. A l’inverse, la recherche et la diffusion du savoir permettent de convaincre sans effort, voire de vaincre sans combattre.
Pouvoir, vouloir, devoir et savoir : voilà donc les quatre verbes qui fondent l’action. Il va de soi que cette articulation s’appuie sur une simplification considérable de questions fort complexes, et que chaque dimension d’un acteur ne peut pas être davantage dissociée des autres que le corps de l’esprit. Ce découpage possède néanmoins l’immense avantage de cerner la vraie nature des conflits : un affrontement basé sur la force, la volonté, la morale et la connaissance. Délimiter les possibilités d’action d’une entité donnée revient ainsi à prendre en compte à la fois ses capacités et ses lacunes, sa volonté et ses inhibitions, sa morale et ses interdits, ses connaissances et son ignorance. Aucune appréciation réaliste d’une situation donnée ne peut omettre ces quatre dimensions propres à l’être humain.
Cette articulation contribue en outre à clarifier l’importance de ces dimensions pour l’action. Alors que les armées privilégient souvent les facteurs physiques, afin que l’intégration des hommes et des machines développe une puissance de destruction ou de protection maximale, ceux-ci ne font pourtant que concrétiser un processus complet. Ainsi, l’efficacité de l’action dépend en premier lieu de la compréhension qu’apporte la connaissance, puis de la légitimation que fournit la morale ; l’action elle-même fait ensuite l’objet d’une décision reposant sur la volonté, avant que son exécution ne dépende des capacités. En d’autres termes, le développement et la transmission de la connaissance doit obligatoirement constituer la priorité de chaque organisation armée.
Enjeux réels et perçus d’un conflit
Il existe cependant une différence essentielle entre la puissance potentielle d’un acteur et celle qu’il exerce effectivement : sa perception des enjeux. De tous temps, les perceptions ont été utilisées pour accroître la détermination de son propre camp, que ce soit par la diabolisation de l’adversaire ou par la glorification à outrance des siens. A Morgarten, les Helvètes étaient vraisemblablement persuadés qu’ils affrontaient des oppresseurs mus par le seul appât du gain, alors que les nobles ne cachaient pas leur mépris pour ces « vachers » irrespectueux des usages et ne méritant aucune pitié. De manière générale, le volume des ressources engagées et la manière de le faire dépendent étroitement des enjeux du conflit, tels que les perçoivent les différents acteurs. Il est donc nécessaire de savoir pourquoi les hommes en viennent à se battre au péril de leur existence. Globalement, les enjeux peuvent être articulés en ordre d’importance par rapport à leur universalité :
- Les enjeux individuels, qui forment l’intérêt minimum de chaque personne – les besoins, les désirs, les impératifs et les informations. Présents dans toutes les situations conflictuelles, ils contribuent à remettre en cause les structures sociales ;
- Les enjeux collectifs, auxquels la socialisation des êtres vivants confère une valeur supérieure – les demandes, les projets, les valeurs et les concepts. Propres à chaque structure sociale, ils définissent par leurs différences les divisions d’une société ;
- Les enjeux sociétaux, qui ont une importance plus grande en définissant chaque société – l’ambition, la destinée, la culture et l’éducation. Représentant l’identité rassemblant les groupes et les individus, ils sont un facteur essentiel d’unité ;
- Les enjeux civilisationnels, enfin, qui correspondent à l’intérêt maximum pouvant être considéré – la survie de tout ou partie de l’espèce humaine. Pris en compte depuis la mise au point de l’arme nucléaire, ils mettent en cause le sens même de l’action armée.
Encore une fois, une telle articulation ne fait qu’approcher la complexité des organisations humaines. Il s’agit néanmoins de s’imaginer l’interaction existant entre ces différents niveaux de la sorte : les structures sociales sont des sommes de personnes, alors que les sociétés sont formées de plusieurs structures ; de même, les valeurs sont une addition d’impératifs, tout comme les cultures forment un ensemble de valeurs. En d’autres termes, les enjeux les plus fondamentaux constituent le dénominateur commun d’une société et parviennent à transcender les différences des structures sociales qui la composent, tout comme les enjeux propres à celles-ci transcendent les différences des individus qu’elles rassemblent. Autant dire que leur nature subjective a une influence directe sur la notion de menace.
Les ressources engagées sont en effet proportionnelles à l’ampleur des enjeux perçus. Un groupe ne se mobilise pas si des besoins ou des impératifs strictement individuels lui semblent en péril, de même qu’une société n’entre pas en guerre lorsque des demandes ou des valeurs sectorielles lui paraissent menacées. En revanche, que des enjeux initialement limités gagnent en importance, ou que l’impression d’un tel phénomène se propage, et aussitôt les acteurs concernés sont-ils susceptibles de s’engager davantage ou de se rapprocher les uns des autres pour cumuler leurs forces. Toucher un être humain au plus profond de lui-même revient à toucher tous les siens, dans toute l’acception fluctuante de ce mot. Chaque individu est en mesure de symboliser des enjeux pour lesquels combattre, tuer et mourir peut être digne.
Cet engrenage de l’identification et de l’amalgame contribue à expliquer pourquoi des conflits a priori limités peuvent engendrer des comportements extrêmes, et totalement irrationnels vus de l’extérieur. La peur de disparaître en tant qu’entité ethnique ou religieuse est ainsi à l’origine des conflits identitaires qui se sont multipliés dans les années 90, alors que l’imitation permet aux modalités de certains conflits d’apparaître en d’autres lieux. Cependant, ce mécanisme indique également la fragilité des acteurs collectifs dès lors que s’effilochent les bases de leur identité : si les enjeux fondamentaux qui fondent sa cohésion ne sont pas menacés, chaque belligérant est aussitôt susceptible d’être confronté à des divisions internes et donc affaibli. Les mouvements de concentration et de dispersion ont dès lors un impact direct sur les ressources disponibles et la manière de les employer.
Ainsi, le principal effet des attentats du 11 septembre a été une élévation brusque et durable des enjeux : la destruction des tours jumelles a représenté une négation si criante des valeurs morales propres à l’humanité que, par effet de réaction, elles ont suscité le soutien politique nécessaire au déclenchement des campagnes d’Afghanistan et d’Irak. En revanche, si la médiatisation de la famine due à la guerre civile en Somalie a provoqué une intervention militaire majeure des Etats-Unis, les enjeux perçus n’étaient pas suffisants pour justifier aux yeux des dirigeants politiques la perte de quelques soldats : malgré le succès tactique incontestable de l’opération du 3 octobre 1993, au cours de laquelle les forces US ont capturé les principaux lieutenants du « général » Aïdid et éliminé plus d’un millier de ses hommes pour 18 morts dans leur camp, l’administration Clinton a ordonné leur retrait.
Cette réalité complexe, faite de subjectivité et d’incertitude, revêt une importance cruciale à une époque où les technologies de l’information favorisent les identités métissées, les collectifs éphémères et les structures éclatées. Il est plus que jamais nécessaire de savoir pourquoi des acteurs acceptent d’employer la violence armée et jusqu’à quelles extrémités ils sont prêts à aller pour atteindre leurs objectifs. Or, démêler l’écheveau humain des conflits armés exige un processus itératif et continu : il s’agit d’une part d’évaluer l’implication des acteurs en fonction des enjeux matériels, émotionnels, moraux et intellectuels qu’ils perçoivent, et donc de comprendre leur point de vue, et d’autre part d’évaluer les mouvements de fusion et de scission qui résultent des convergences et des divergences au sujet de ces enjeux.
L’exemple de la société israélienne est éclairant. Durant les années 90, les Forces de défense israéliennes déployées au Sud-Liban ont subi les effets de la guérilla menée par le Hezbollah ; les pertes inévitables dans leurs rangs ont soulevé le refus croissant d’une partie du public, qui ne jugeait pas vital le maintien des troupes hors du territoire, et donc provoqué un affaiblissement psychologique aboutissant à un retrait précipité, au printemps 2000, qui sera pour beaucoup dans la décision de l’Autorité palestinienne de déclencher sa deuxième Intifada. Mais cette véritable guerre, contrairement à la première, a ressoudé la société israélienne : les attentats suicides menés sur le territoire de l’État juif, par leur caractère immoral et aveugle, ont élevé les enjeux et fourni une majorité confortable au gouvernement Sharon pour durcir sa politique et ériger une barrière de séparation.
Cette évaluation des perceptions fluctuantes au niveau des enjeux constitue cependant une boucle exclusivement axée sur le renseignement, et permettant de connaître les acteurs en présence. L’étape suivante consiste donc à cerner les possibilités d’action.
Action frontale, oblique, distante et virtuelle
Quel que soit le contexte dans lequel elle s’inscrit, l’action doit être pensée en fonction des effets qu’elle provoque chez les acteurs réels ou potentiels d’une situation, et donc dans sa dimension physique, psychologique, éthique et cognitive. Dans un conflit contemporain, mener une action signifie affecter délibérément les capacités, les volontés, la légitimité et l’opportunité de sa cible en fonction d’objectifs précis. La difficulté provient du fait que les effets atteints peuvent s’opposer en fonction des dimensions et dépasser largement la cible visée. User par exemple d’une violence maximale au combat contribue certes à réduire encore davantage les moyens adverses, mais peut susciter dans les opinions publiques une réaction de solidarité contre-productive. L’action doit donc être différenciée en fonction des effets recherchés.
Tenter d’affecter un acteur donné, quel que soit son degré d’opposition ou de soutien, constitue une action offensive, alors que tenter de se prémunir contre un tel effet constitue une action défensive ; enfin, augmenter les effets de l’une ou de l’autre constitue une action d’appui. Le choix entre attaque et défense dépend des objectifs propres à l’acteur considéré : un objectif restant à atteindre nécessite plutôt une action offensive, alors qu’un objectif atteint suppose davantage une action défensive. De même, le choix du type d’attaque dépend de l’urgence des effets attendus, et un acteur pressé d’obtenir une décision sera contraint d’adopter une méthode plus directe qu’un acteur jouissant d’une plus grande latitude temporelle. Il est donc nécessaire de décrire les différents modes d’attaque pour délimiter les possibilités d’action.
La pensée stratégique traditionnelle distingue à cet égard l’approche directe et indirecte. Pourtant, dans la mesure où elle ne s’applique vraiment qu’à des belligérants déclarés, cette distinction ne suffit plus à décrire l’ensemble des interactions d’un théâtre d’opérations contemporain, ou des sociétés qui de plus en plus souvent en tiennent lieu. Les effets produits avant, pendant et après un conflit – ou même en son absence si celui-ci a été prévenu – ont tous une influence sur les rapports de force des acteurs considérés. En d’autres termes, c’est l’ensemble des effets touchant les capacités, la volonté, la légitimité et l’opportunité d’agir qui doivent être déterminés. Ce qui impose une articulation nouvelle de l’action, offensive comme défensive.
A notre sens, l’une comme l’autre peuvent ainsi être menées de manière frontale, oblique, distante ou virtuelle :
- En mode frontal, l’attaque a pour but d’atteindre au plus vite le centre de gravité d’un acteur, que l’on peut définir comme le pivot de toute sa puissance, et donc à obtenir la décision en l’empêchant de faire encore usage de ses ressources. La destruction de l’armée irakienne au Koweït en 1991 sous 82’000 tonnes de bombes, la paralysie de l’armée française en mai 1940 par l’action en profondeur des Panzerdivisionen, l’accusation de torture systématisée faite à l’armée américaine en 2004 suite à la publication d’images de sévices ou la profusion d’informations provoquée par l’offensive du Têt au Vietnam, en 1968, forment des exemples d’actions – dans nos 4 domaines respectifs – visant des centres de gravité clairement identifiés ;
- En mode oblique, l’attaque vise à réduire progressivement les ressources d’un acteur et à en limiter le libre usage, et donc à restreindre peu à peu sa liberté d’action – en particulier lorsqu’une attaque frontale reste inconcevable ou irréalisable. L’usure de la flotte sous-marine allemande dans la Bataille de l’Atlantique pendant la Seconde guerre mondiale, la déstabilisation croissante du Gouvernement serbe lors de la campagne aérienne du Kosovo en 1999, la suspicion entretenue sur les effets supposés de l’uranium appauvri dans les Balkans en 2001 ou la confusion entourant les préparatifs de l’opération « Iraqi Freedom » dès 2002 forment des exemples d’actions réduisant au fil du temps la liberté d’action de la cible ;
- En mode distant, l’attaque tente d’imposer à un acteur l’engagement contre-productif de ses ressources, et donc à faire en sorte qu’il mène des actions défavorables à ses intérêts – en particulier lorsqu’une attaque ouverte n’est pas dans le domaine du possible. L’épuisement de l’Union soviétique par l’Initiative de défensive stratégique américaine dès 1983, la frustration des forces françaises par les Viets insaisissables en Indochine, la provocation des pertes civiles par l’usage de boucliers humains en Irak ou la déception orchestrée par les Alliés pour faire croire à un débarquement dans le Pas-de-Calais en 1944 forment des exemples d’actions aboutissant à faire prendre de mauvaises décisions par la cible ;
- En mode virtuel, enfin, l’attaque tente de susciter chez un acteur l’engagement de ses ressources dans le sens de l’attaquant, et donc à faire en sorte qu’il mène des actions favorables à celui-ci – sans que cela ne forme apparemment une attaque. Le désarmement coordonné de la Russie à la fin de la guerre froide pour réduire son arsenal chimique, la séduction exercée par la coalition en Irak pour inciter les Irakiens à ne pas la combattre, le sermon orchestré au milieu des années 90 par la campagne contre les mines antipersonnel pour retirer celles-ci aux armées ou la dissuasion exercée par les armes nucléaires sur des agresseurs potentiels forment des exemples d’actions aboutissant à faire prendre à la cible des décisions favorables.
Les actions offensives dans le domaine physique prennent la forme de l’attrition, qui consiste à réduire la capacité d’agir en affectant les ressources matérielles, et dont l’endurance constitue le pendant défensif. Dans le domaine psychologique, il faut parler de manœuvre pour représenter les actions offensives visant à réduire la volonté d’agir en affectant les ressources émotionnelles, et de résistance pour désigner les actions visant à s’y opposer. Les actions offensives dans le domaine éthique reposent sur la contrainte, c’est-à-dire la réduction de la légitimité à agir en affectant les ressources morales, alors que l’intégrité permet de s’en défendre. Dans le domaine cognitif, enfin, les actions offensives relèvent de l’obédience, car elles visent à réduire l’opportunité d’agir en affectant les ressources intellectuelles, et seule l’intelligence – dans la pleine dimension de ce mot – permet de s’en prémunir.
Cette articulation basée sur 4 domaines, 4 modes et 3 orientations fournit le cadre de l’ensemble des actions susceptibles d’être planifiées, exécutées, conduites et évaluées. Elle indique également le caractère plus ou moins brutal et tangible d’une action et replace dans leur contexte les formes de combat classiques : si la destruction reste l’expression même de la guerre en prenant la forme d’une attaque physique frontale, une attaque cognitive virtuelle comme la dissuasion peut s’avérer tout aussi utile dans un conflit ou en-dehors, et même davantage. Ce modèle montre aussi que, par définition, une action a des effets simultanés dans tous les domaines, mais qu’un acteur peut varier son exposition en fonction des modes utilisés, notamment en évitant des attaques ouvertes. Ce qu’un ensemble composite d’acteurs ponctuellement liés est encore davantage à même d’entreprendre.
Cela nous amène, enfin, à redéfinir les sources de la puissance. Les tonnes d’équipements, l’idéalisation du martyre, la vertu faite politique ou la pénétration des vues ne sont pas en soi suffisantes pour accéder à la supériorité, alors que les rapports de force à l’œuvre dans un conflit moderne vont bien au-delà des estimations découlant du nombre ou de la technologie. Les capacités axées sur la matière, la volonté issue des sentiments, la légitimité fondée par la morale et l’opportunité due aux connaissances doivent toutes être prises en compte pour apprécier les forces et les faiblesses respectives des acteurs, et imaginer comment leur interaction peut amener à choisir le domaine et la forme de l’action.
Conclusion
Le modèle décrit dans le cadre de cet article fournit quelques réponses aux interrogations sur le déroulement des conflits contemporains. Si le public américain tolère aujourd’hui des pertes non négligeables en Irak et continue de soutenir la poursuite de l’opération, c’est parce qu’une majorité perçoit ses enjeux comme touchant aux valeurs de leur société, à la différence de l’intervention dite humanitaire en Somalie. De même, les attentats-suicides complètement immoraux frappant la population israélienne l’ont très largement convaincue de la nécessité vitale de répliquer et de combattre les groupes terroristes palestiniens. Enfin, la réaction majoritaire de la population espagnole s’explique précisément par le fait qu’elle ne perçoit pas le terrorisme islamiste comme une menace directe pour les fondements de son existence.
Comprendre la guerre moderne consiste à comprendre ceux qui la font, par les armes et les slogans, par les bombes et les images, par les dons et les menaces. Une époque qui conjugue l’interpénétration des causes, l’écorchement des identités et les traumatismes du changement facilite à un degré inédit la mise en réseau des individus et leur passage à l’acte ; il en découle une multiplication des acteurs et une sensibilisation des spectateurs qui bouleversent totalement la vision binaire et symétrique du combat. Seule l’analyse détaillée des causes et des effets matériels, émotionnels, moraux et cognitifs permet de surmonter la subjectivité des perceptions et de cerner l’éventail des actions possibles. En admettant que des activités a priori anodines, comme les pressions morales ou l’exportation des cultures, font partie des rapports de force au sein des sociétés et entre elles.
L’évolution du monde a en effet élargi les méthodes de lutte traditionnelles, et les résultats obtenus jadis par une invasion militaire ou par une campagne de terreur peuvent aujourd’hui être reproduits – en modifiant risques et délais – par le dénigrement systématique ou par la circulation des idées. Lorsqu’une image télévisée, une histoire réécrite, une interview manipulée, une aumône déguisée, un logiciel invisible ou un pétrolier détourné deviennent des armes au même titre qu’un chasseur-bombardier ou un fusil de précision, c’est la compréhension même du combat – en tant qu’expression d’une puissance déterminée – qui doit être revue. Et donc l’appréhension des acteurs réels ou potentiels d’un conflit, qu’il s’agisse de combattants affichés ou non, d’organisations ou de personnages exerçant délibérément des effets physiques, psychologiques, éthiques et cognitifs.
Cette mutation de la guerre n’a en soi rien d’inédit. A travers les âges de l’humanité, l’évolution des technologies et des mœurs a imposé la transformation des outils militaires et des sociétés qui les produisaient. Chaque époque a ainsi connu une forme d’organisation assurant la supériorité grâce à une symbiose entre armée, gouvernement et population ; en conjuguant à un rythme accéléré le progrès technologique et la recomposition sociale, notre siècle exige à son tour une adaptation constante des armées et des stratégies de défense. Cerner le quadrant de la puissance et élargir l’analyse des rapports de force constitue la première étape de toute réflexion à ce sujet.
Lt col EMG Ludovic Monnerat
Cet article a été publié initialement dans la Revue Militaire Suisse en août/septembre et octobre 2005, et l'auteur remercie son rédacteur en chef, le colonel Hervé de Weck, de l'avoir autorisé à le republier.
Par ailleurs, un exposé avec support PowerPoint développant et prolongeant les thèmes traités ci-dessus a été réalisé. Modulable de 60 à 120 minutes, cet exposé a déjà été présenté à plusieurs reprises, en particulier dans le cadre de l'instruction donnée au sein service de renseignement militaire suisse. Toutes les organisations civiles et militaires intéressées à l'entendre peuvent sans autre prendre contact.
© 1998-2005 CheckPoint |