Pourquoi l’attrition et le sang versé restent
le paradigme central de tous les conflits armés
11 juillet 2004

nfluencées par nos sociétés aisées, les armées tendent à discréditer l’importance des pertes ennemies et recherchent des victoires sans effusion de sang ou presque. Selon l’analyste américain Ralph Peters, cette illusion dangereuse doit être combattue à chaque occasion : convaincre l’ennemi de sa défaite passe par la mort des siens.
Au sein des Forces armées américaines, le danger d’accepter la sagesse traditionnelle fait désormais partie de cette sagesse traditionnelle. Malgré nos éloges symboliques pour la créativité et l’innovation, nous prenons rarement le temps de remettre en question nos principes de base. Bien entendu, ceci s’explique en partie par le fait que les officiers de l’US Army et du Corps des Marines vivent aujourd’hui à un rythme propre à la guerre, avec peu de loisir pour la réflexion. Mais ce sont avant tout les préjugés profonds qui se sont infiltrés dans nos armées – tout comme dans la société civile – qui masquent des vérités essentielles.
Le meilleur exemple de nos erreurs irréfléchies n’est autre que le rejet du terme « guerre d’attrition ». La conviction que l’attrition – en tant qu’objectif ou résultat – est intrinsèquement négative est simplement fausse. La mission d’un soldat consiste à tuer l’ennemi ; tout le reste, quelle que soit son importance apparente, est secondaire. Et tuer l’ennemi revient à pratiquer l’attrition. Toutes les guerres qui font voler les balles – ou les flèches – sont des guerres d’attrition.
L’équilibre entre le feu et la manœuvre
Naturellement, le terme « guerre d’attrition » fait référence au massacre répétitif du front occidental durant la Première guerre mondiale, avec ses pertes massives de part et d’autre. L’an passé, lorsque les journalistes voulaient dénigrer les efforts des militaires américaines dans l’occupation de l’Irak, le terme a émergé sans cesse. La notion selon laquelle même tuer l’ennemi est une mauvaise chose en temps de guerre, de plus, a été exacerbée par les prétentions de l’industrie de défense, appuyée par les militaires carriéristes et baratineurs, affirmant que les armes de précision et la technologie en général ont irrévocablement changé la nature de la guerre. Mais celle-ci ne change jamais – seulement ses manifestations superficielles.
L’US Army a aussi grandement amoindri sa propre compréhension intellectuelle et pratique de la guerre en multipliant les théories, notamment dans les années 80. Les théories ne gagnent pas les guerres ; ce sont les soldats bien entraînés et bien conduits des armées bien équipées qui le font. Et ils le font en tuant avec efficacité. Nous avons néanmoins entendu maintes absurdités décrivant la « guerre de manœuvre » comme solution à tous nos malheurs, depuis notre désavantage numérique vis-à-vis du Pacte de Varsovie jusqu’au fait que notre « défense active » le long de l’ancienne frontière allemande n’était qu’une folie politique et une feinte militaire – et, à dire vrai, le meilleur qu’une armée évidée par le Vietnam puisse espérer faire.
La manœuvre n’est pas une solution en soi, pas davantage que la technologie. Elle forme un équilibre sans cesse changeant avec le feu. On ne peut se passer ni de l’un, ni de l’autre. Cela semble évident, mais ce n’est pas toujours l’évidence qui est reconnue et recherchée. Ceux qui recherchent la théorie préfèrent toujours l’ésotérique au réel.
Un tout petit nombre de campagnes militaires ont été remportées uniquement par la manœuvre – au moins depuis la Renaissance et les jours des batailles entre condottieri. La campagne de Napoléon à Ulm, la marche japonaise sur Singapour et quelques autres exemples résument la courte liste des victoires « sans coup férir ».
Même des campagnes qui apparaissent comme des triomphes de la manœuvre se révèlent, en définitive, des succès reposant sur une combinaison dynamique du feu et de la manœuvre. La phase d’ouverture conventionnelle de la guerre de 1870, culminant avec le grand enveloppement de Sedan, est souvent citée comme un exemple de manœuvre brillante au niveau opératif – bien que la route de Paris ait compté plus de cadavres allemands que français. C’était une guerre sanglante qui a été menée par le mouvement. D’autres campagnes dont le succès a été construit sur des manœuvres audacieuses ont également exigé des batailles d’attrition en cours de route ou à leur point culminant, depuis la brillante concentration de Moltke sur plusieurs axes à Koenigsgraetz jusqu’au blitzkrieg allemand contre les Polonais, les Français et les Russes, en passant par l’opération Desert Storm, au cours de laquelle des manœuvres opératives audacieuses ont positionné la puissance de feu tactique nécessaire à des engagements âpres et brefs. Même le débarquement d’Inchon, l’une des opérations les plus risquées menées par un commandant américain, n’a pas réussi à mettre un terme à la Guerre de Corée.
Plus souvent qu’à l’inverse, une confiance exagérée dans une manœuvre opérative téméraire pour gagner une campagne rapide a mené à la désillusion, et même au désastre. On peut discuter pendant des siècles quant au retrait de 6 divisions allemandes du flanc droit du Plan Schlieffen en 1914, mais cette tentative de gagner la guerre en une poussée rapide a mené à plus de 4 ans de blocage sur le front occidental. Pendant la même saison, la grandiose manœuvre russe près des lacs Masuriens s’est effondrée devant les contre-manœuvres et les batailles de rencontre – une défense active allemande tirée de la « stratégie de la position centrale » appliquée par Napoléon – pendant que, en Galicie, une manœuvre agressive s’est révélée être la mauvaise pour les armées austro-hongroises, mal préparées à une telle forme de combat.
Il n’y a pas d’alternative à faire couler le sang de l’ennemi. Malgré des victoires initiales axées sur la manœuvre contre la Russie et dans le désert d’Afrique du Nord, la volonté allemande d’employer la manœuvre pour compenser une puissance de feu inadéquate a finalement mené à la destruction des armées nazies. A réitérées reprises depuis la campagne désastreuse de Lee à Gettysburg jusqu’à la course au Yalu en Corée, une confiance excessive dans les capacités d’une armée à maintenir sa puissance durant des grandes manœuvres a provoqué des revers stupéfiants. Les résultats n’étaient pas une affaire de point culminant clausewitzien, mais provenaient de stratégies fondamentalement défectueuses.
L’opération Iraqi Freedom, l’une des campagnes militaires les plus réussies de l’histoire, était conçue comme une nouvelle forme de guerre de manœuvre, dans laquelle les frappes aériennes devaient « choquer et effrayer » un adversaire contraint à la reddition pendant que les forces terrestres devaient d’un rôle secondaire. Mais au lieu de reposer sur des technologies en mouvement, la guerre de 3 semaines a été menée et gagnée – de manière triomphale – par des soldats et des marines employant à la fois des manœuvres opératives agressives et une puissance de feu tactique dévastatrice.
Il ne s’agit de dire que la manœuvre est moins importante que le feu, mais qu’il n’y a pas de réponse unique au champ de bataille – pas de formule. La nécessité antique pour chaque commandant d’équilibrer des mouvements incisifs avec l’application des armes ne va probablement pas changer, même bien au-delà de notre vivant. Ce n’est pas un domaine exclusif, mais une question d’intégration pour chaque cas spécifique.
La destruction pour imposer la défaite
Bien qu’aucune campagne ne soit identique à une autre, le modèle de la guerre pour la superpuissance américaine devrait ressembler à ceci : une manœuvre stratégique, puis une manœuvre opérative pour déclencher des feux, et des feux tactiques pour autoriser d’autres manœuvres. Les feux stratégiques jouent un rôle croissant, bien qu’ils ne remportent pas les guerres. Bien sûr, aucun champ de bataille n’est aussi simple que cette proposition, mais toute force qui oublie de se concentrer sur la destruction rapide et poursuivie de l’ennemi jusqu’à sa reddition sans conditions se paralyse elle-même.
Nous n’entrons pas dans l’âge de la manœuvre, mais dans celui de nouvelles guerres d’attrition. Premièrement, la guerre contre le terrorisme religieux est sans conteste une guerre d’attrition – si l’un de vos ennemis est laissé vivant ou en liberté, il va continuer de vouloir vous tuer et détruire votre civilisation. Deuxièmement, l’opération Iraqi Freedom et ses manœuvres fulgurantes ont fourni un nouvel exemple de guerre d’attrition postmoderne – dans laquelle les pertes sont totalement déséquilibrées.
Personne n’a jamais dit que les guerres d’attrition devaient être justes. Il est essentiel de purger nos esprits de tous les clichés évoqués par le terme de « guerre d’attrition ». Nous ne recherchons certainement pas des guerres dans lesquelles d’énormes pertes sont équitablement réparties entre nos propres forces et celles de l’ennemi. Mais une guerre d’attrition unilatérale, fondée par notre vaste gamme de capacités supérieures, est un modèle fort pour le méthode américaine de guerre au XXIe siècle.
Aucun modèle n’est applicable en permanence. C’est un fait acquis – ou qui devrait l’être. Les guerres créent des exceptions, au chagrin éternel des commandants militaires et pour l’embarras fréquent des théoriciens. L’une de nos grandes forces nationales et militaires est notre faculté d’adaptation. A la différence de nombreuses autres cultures, nous avons une aversion quasi primale pour les contraintes de la théorie, et notre indépendance d’esprit nous sert à merveille. Mais les théoriciens sont toujours parmi nous, comme des diables chuchotant à nos oreilles, nous disant que la puissance aérienne va gagner cette guerre, que le « renseignement » par satellite réduit le besoin d’efforts humains, ou qu’un ennemi mortel va être persuadé de se rendre par un spectacle son et lumières.
Les armes de précision ont sans aucun doute une valeur, mais elles sont coûteuses et ne causent pas de destructions suffisantes pour impressioner un ennemi endurci. La première fois qu’une bombe guidée frappe le bureau d’un adjoint, elle attirera l’attention de son chef, mais si l’armement de précision manque à la fois d’annihiler le leadership ennemi et de convaincre l’armée ainsi que la population qu’ils ont été battus, ce sera comme toujours au soldat de faire le travail. Ceux qui vivent dans des nuages technologiques ne saisissent pas à quel point la destruction doit être visible et complète pour persuader un adversaire de sa défaite.
Il faut se concentrer sur le fait de tuer l’ennemi. Avec le feu. Avec le mouvement. Avec des bâtons, des cailloux et des graisses non saturées. Dans une armée disciplinée, des chefs et des soldats agressifs peuvent toujours être contenus. Mais il est difficile de persuader des chefs accoutumés à la prudence que leur mission n’est pas de garder en ligne des chars de tout un corps, mais de plonger au cœur de l’ennemi pour le détruire. Nous avons fait de grands progrès depuis le ballet de Desert Storm – uniquement « gâché » par l’insistance du major-général Barry McCaffrey à rompre l’ensemble choral et frapper l’ennemi au lieu du vide – jusqu’à l’esprit visant à rechercher le contact, démontré dans la course sur Bagdad de l’an passé.
Dans les années amères de l’après-Vietnam, lorsque nos dirigeants nationaux ont succombé au mythe que le peuple américain ne tolère pas les pertes, des éléments au sein des Forces armées – mais non la totalité – sont devenus timides sur le plan moral et pratique. Au milieu des années 90, le mot d’ordre informel de l’US Army semblait être « nous ne nous battrons pas, et vous ne nous aurez pas. »
Il existe des raisons évidentes pour cela. Les militaires – spécialement dans l’armée et les Marines – se sont sentis trahis par les dirigeants politiques à propos du Vietnam. Ensuite, le Président Reagan a retiré les troupes de Beyrouth peu après l’attaque de la caserne des Marines en bordure de la ville, initiant une longue série de retraits face au terrorisme qui ont finalement mené au 11 septembre. Nous avons touché le fond à Mogadiscio, lorsque des Rangers, des éléments des opérations spéciales et des soldats réguliers ont infligé des coups dévastateurs aux miliciens du général Aïdid, avant que le Président Clinton déclare la défaite en ordonnant le retrait. On peut discuter les raisons de notre présence en Somalie et le danger d’une dérive de la mission, mais lorsque l’on est au milieu d’un combat, il faut le gagner – et rester sur le champ de bataille suffisamment longtemps pour convaincre ses ennemis qu’ils ont perdu sur tous les tableaux.
Les choses ont commencé à changer moins de 2 semaines après le déclenchement de la campagne d’Afghanistan. Au premier abord, il y avait une certaine prudence – est-ce que le nouveau Président allait tourner casaque dès les premières pertes ? Puis lorsqu’il vint à l’esprit des commandants que l’administration soutiendrait les armées, nous avons vu l’une des campagnes les plus innovatives de l’histoire militaire se dérouler à une vitesse stupéfiante.
Utiliser la puissance sans remords
Les Forces armées américaines, et notamment l’armée, reviennent de loin. Mais elles sont toujours convalescentes – presque sorties des séquelles de la guerre froide, mais toujours trop vulnérables aux absurdités concoctées par les théoriciens scotchés à leurs bureaux. Visant à évaluer les leçons apprises de l’Irak, une récente étude d’un grand commandement interarmées a mentionné le besoin de dialogues entre les commandants et leurs états-majors à différents niveaux.
Faites moi confiance. Nous n’avons pas besoin de dialogues. Nous avons besoin de propos directs, de réponses honnêtes, de la volonté de rechercher l’ennemi et de le tuer. Et de continuer à le faire jusqu’à ce que le monde entier sache clairement qui a gagné. Lorsque les officiers commencent à parler dans un charabia académique, c’est qu’ils ne contribuent en rien à l’efficacité de nos forces. Un déploiement à Falloujah leur ferait le plus grand bien.
Considérez nos ennemis dans la guerre au terrorisme. Des hommes qui croient littéralement être envoyés par Dieu pour détruire notre civilisation et qui voient la mort comme une promotion ne sont pas impressionés par les manœuvres élégantes. Il faut les retrouver, quel que soit le temps nécessaire, et les tuer. S’ils se rendent, il faut leur accorder les droits contenus dans les lois de la guerre et les conventions internationales. Mais comme nous l’avons douloureusement appris avec les idioties gauchistes proférées sur les prisonniers de Guantanamo, nous avons bien meilleur temps de les tuer avant qu’ils n’aient une chance de se rendre.
Nous entendons sans cesse des déblatérations sur la guerre réseau-centrique, pour le grand bénéfice des industriels de la défense. Si vous voulez un exemple superbe – et modique – de « guerre-réseau », il suffit de regarder Al-Qaïda. La seule possession de la technologie ne garantit pas qu’elle sera utilisée efficacement. Et l’efficacité est ce qui compte vraiment.
Il ne s’agit pas de vouloir ou non mener une guerre d’attrition contre des terroristes mus par la religion. Nous sommes déjà dans une guerre d’attrition avec eux. Nous n’avons pas d’autre choix réaliste. En fait, nos ennemis sont à certains égards mieux adaptés que nous à des guerres de manœuvre globales et locales. Ils peuvent se dissimuler dans le monde entier, alors que ce dernier regorge de cibles. Ils ne doivent pas respecter de lois ou de frontières. Ils ne signent ou n’observent aucun traité. Ils n’attendent pas l’approbation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ne font pas face à des cycles d’élection. Et leurs armes sont largement fournies par nos propres sociétés.
Nous avons les capacités techniques d’effectuer des déploiements à portée globale, mais nous sommes pour l’instant contraints de regarder les forces pakistanaises échouer dans leurs efforts pour encercler et détruire des concentrations de terroristes ; nous ne pouvons entrer dans aucun pays (à l’exception, temporaire, de l’Irak) sans la permission de son Gouvernement. Nous avons de nombreux outils – militaires, diplomatiques, économiques, culturels, judiciaires, etc. – mais moins de liberté de manœuvre que nos ennemis.
Mais nous avons une puissance de destruction supérieure, une fois que ces ennemis ont été localisés. En définitive, l’avantage principal d’une superpuissance est une puissance supérieure. Face à des ennemis implacables qui tueraient chaque homme, femme et enfant de notre pays et approuveraient leur mort (la guerre d’attrition ultime), nous devons être disposés à utiliser cette puissance sagement, mais sans remords.
Sur le plan militaire et national, nous sommes dans une phase de transition. Même après le 11 septembre, nous ne mesurons pas entièrement la cruauté et la détermination de nos ennemis. Nous allons apprendre la leçon dans la douleur, parce que les terroristes ne vont pas renoncer. La seule solution est de les tuer et de continuer à le faire : une guerre d’attrition. Mais une guerre d’attrition menée à nos conditions, et non aux leurs.
Bien entendu, nous entendrons sans fin les arguments stupides selon lesquels nous ne pouvons résoudre le problème en nous contentant de tuer. Mais jusqu’à ce qu’une meilleure méthode soit découverte, tuer chaque terroriste que nous pouvons trouver est une bonne solution intérimaire. La vérité, c’est que même en ne pouvant supprimer le problème par la seule destruction, vous pouvez grandement le réduire par un ciblage efficace.
Nous entendrons aussi que tuer des terroristes ne fait que créer d’autres terroristes. Voilà bien une idiotie d’étudiant. La manière la plus sûre de grossir les rangs des terroristes est de suivre l’approche des années 90 et de ne rien faire de concret. Le succès engendre le succès. Tout le monde aime les vainqueurs. Les clichés existent parce qu’ils sont réels. Al-Qaïda et les groupes terroristes affiliés se sont métastasés parce qu’ils ont semblé, au sein du monde musulman, résister avec succès à l’Occident et infliger en toute impunité des défaires embarrassantes au Grand Satan américain. Quelles que soient nos actions, certains fanatiques vont toujours rejoindre des organisations terroristes. Mais il est bien plus facile pour les sociétés islamiques de se débarrasser des terroristes si ceux-ci sont les perdants d’une lutte globale que s’ils deviennent les héros triomphants de chaque adolescent instable et désoeuvré du Moyen-Orient et d’ailleurs.
Une chose bien pire que mener agressivement une telle guerre d’attrition est de faire semblant d’ignorer celle-ci pendant que votre ennemi continue à vous tuer.
Même l’occupation de l’Irak est une guerre d’attrition. Nous la menons remarquablement bien, compte tenu des contraintes sous lesquelles opèrent nos forces. Mais aucune manœuvre grandiose, aucun geste d’humanité, aucune offre de conciliation et aucun compromis ne persuaderont les terroristes de renoncer à vouloir interrompre le développement d’un Irak démocratique et régi par la loi. Au contraire, toute autre chose qu’une traque implacable, comprenant des actions préemptives comme des représailles, ne fera qu’encourager les terroristes et les derniers gangsters baasistes.
Une guerre d’attrition longue et pénible
Face à des terroristes endurcis, l’objectif n’est pas de mener des opérations psychologiques, de créer des emplois ou de déployer des équipes de soins dentaires, mais bien de les tuer. Même en ce qui concerne la population en général, qui bénéficie de nos efforts en matière de reconstruction et de développement, la meilleure chose que nous puissions faire pour elle est de tuer les terroristes et les insurgents. Tant que les Irakiens ne seront pas en sécurité, ils ne seront pas vraiment libres. Les terroristes le savent. Nous affectons de penser autrement.
Ce sera une guerre longue, qui s’étendra bien au-delà de notre vivant. Et ce sera une longue guerre d’attrition. Nous devons garantir que les pertes sont toujours disproportionnées en face. Curieusement, alors que nos Forces armées évitent un « body count » en Irak – ceux-ci ont une réputation au moins aussi mauvaise que les guerres d’attrition – les médias insistent pour en tenir un. C’est triste à dire, mais le décompte des pertes chéri par les médias est le nombre de nos propres soldats morts ou blessés. Avec notre prudence excessive, nous avons permis aux médias de créer une perception selon laquelle les pertes sont essentiellement dans notre camp. En renonçant à décompter les pertes ennemies, nous créons l’impression de notre propre défaite. Dans une guerre d’attrition, les nombres comptent.
Quant aux autres formes postmodernes de guerre d’attrition – les opérations conventionnelles à haute vitesse dans lesquelles la manœuvre, la puissance de feu, la vitesse et le choc se conjuguent pour dévaster une force adverse – l’Army et le Corps des Marines ont besoin de les adopter, au lieu de laisser les services techniques, l’Air Force et la Marine, définir le futur de la guerre. Nous ne verrons pas de sitôt un ensemble magique de technologies atteindre des victoires significatives sans coûter une seule vie humaine. Nous devons combattre à chaque occasion cet énorme mensonge. Les premières décennies du XXIe siècle au moins seront dominées par cette guerre sournoise et meurtrière que nous avons vue de Manhattan à Bali, de la plaine de Shamali à Nasiriyah, de Falloujah à Madrid.
Le problème, c’est que le Département de la Défense combine deux types d’armées d’un genre totalement différent. Dans l’Air Force et la Marine, les hommes servent les machines. Dans l’Armée et les Marines, les machines servent les hommes. Bien que les technologies coûteuses peuvent avoir une grande utilité, les services techniques ont une utilité nettement amoindrie dans la gamme étendue d’opérations que nous devons accomplir, des raids urbains aux occupations prolongées, des patrouilles à pied dans des environnements lointains au maintien de la paix.
La Marine se débat farouchement avec ces problèmes, mais l’Air Force est la plus réticente à admettre que nous affrontons des guerres d’attrition, car elle a lourdement investi dans des armes de précision conçues pour gagner des guerres en « déconstruisant » les réseaux de commandements ennemis. Mais la seule manière de paralyser définitivement les réseaux de commandement d’organisation terroristes est de tuer des terroristes. Même si durant l’opération Iraqi Freedom la puissance aérienne a fourni une contribution inestimable, attaquer les infrastructures militaires et gouvernementales n’a pas pu remplacer la destruction des forces ennemies. Lorsqu’au milieu de la guerre la priorité de l’effort aérien est passée des frappes sur le leadership à la destruction de l’équipement militaire irakien et des troupes ennemies, son utilité a brutalement augmenté.
On ne peut pas le répéter assez souvent : quel que soit votre objectif en temps de guerre, il ne faut jamais perdre de vue celui de tuer l’ennemi. Un certain nombre de problèmes survenus dans les suites de l’opération Iraqi Freedom sont dus au fait que nous avons essayé de modérer les destructions infligées aux Forces armées irakiennes. Le seul résultat a été l’essor d’une légende irakienne du « coup de poignard dans le dos », une notion selon laquelle ils n’ont pas vraiment été battus mais trahis. Comme les troupes coalisées étaient de plus en nombre insuffisant pour couvrir le pays – en particulier dans le triangle sunnite – dans les semaines suivant immédiatement la chute du régime, des portions cruciales de la population n’ont jamais vraiment ressenti la puissance américaine.
Il ne suffit pas de battre matériellement votre ennemi. Vous devez le convaincre qu’il a été battu. Et il est impossible d’y parvenir en bombardant des bâtiments vides : il faut être prêt à tuer pour sauver des vies à court terme et favoriser la paix à long terme.
Ce texte ne part pas du principe que la guerre consiste simplement à se déplacer et à tuer. Il va de soi que des attaques incisives sur des capacités de commandement et contrôle, des opérations psychologiques bien pensées et un traitement humain des civils ainsi que des prisonniers ont une profonde importance, au même titre que d’autres facteurs complexes. Mais à une époque où des industriels margoulins et des « experts » qui n’ont jamais porté l’uniforme se font les prophètes de guerres sans effusion de sang et de victoires propres grâce à la technologie, il est essentiel que ceux qui doivent concrètement faire la guerre ne succombent pas aux théories faciles et au vocabulaire clinquant émanant de bureaux confortables.
Il ne s’agit donc pas de savoir si l’attrition est bonne ou mauvaise : elle est nécessaire. C’est seulement en faisant couler leur sang que l’on défait des ennemis résolus. Dans notre lutte contre des terroristes obsédés par Dieu, les ennemis les plus implacables que notre nation ait jamais affrontés, il n’y a pas de solution économique. Sans aucun doute, notre stratégie à long terme doit inclure une large gamme d’efforts pour influencer de l’extérieur l’environnement dans lequel le terrorisme croit et prospère. Mais pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire, c’est impressionner nos ennemis, nos alliés et toutes les populations entre deux, que nous gagnons et que nous continuerons à le faire. Et la seule manière de le faire passe par tuer.
Texte original: Ralph Peters, "In Praise of Attrition", Parameters, Summer 2004 © 1998-2004 CheckPoint
Traduction et réécriture: Lt col EMG Ludovic Monnerat
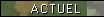

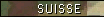
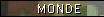

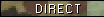
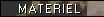


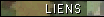

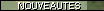


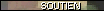
Reproduction d'extraits avec mention de la provenance et de l'auteur