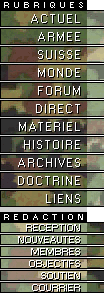








L'opération Iraqi Freedom,
une guerre de la « Troisième Vague » ?
21 septembre 2003

a guerre en Irak n'a pas consacré les principes vantés par les futurologues Alvin et Heidi Toffler. Evolution plus que révolution, elle a au contraire montré la rémanence des concepts classiques de la stratégie. Analyse détaillée.
On avait dit d'elle qu'elle serait une Blitzkrieg d'un genre nouveau, une déferlante technologique implacable qui allait s'abattre tel un rouleau-compresseur sur les résidus de forces irakiennes, bref un modèle d'engagement des infrastructures et plate-formes les plus sophistiquées. Pourtant, avec le recul que l'on peut en avoir à l'heure actuelle, l'opération «Iraqi Freedom» (OIF) ne semble pas s'être radicalement détachée des conceptions classiques guidant les opérations militaires. Les dernières innovations technologiques, bien que présentes sur le terrain des opérations, furent discrètes. Même si la transformation des forces US est bien réelle, sa nature exacte dépasse l'acquisition des seuls équipements.
Faute de budgets et face aux pressions bureaucratiques, Donald Rumsfeld a ainsi dû revoir au rabais son ambition de constituer une armée technologique et a insisté davantage sur une dimension organisationnelle qui a longtemps souffert des rivalités interservices au sein du Département de la Défense.
La Troisième Vague des Toffler
Or, de ce point de vue, la guerre d'Irak a remis en évidence ces rivalités : les Marines et l'Army ont été placés quasiment sur pied d'égalité. Mais elle a aussi permis d'en apaiser d'autres, permettant ainsi d'utiliser la puissance aérienne en soutien des forces terrestres comme des frappes stratégiques, de façon optimale.
On est donc loin des visions quelque peu réductrices d'auteurs tels qu'Alvin et Heidi Toffler, ces futurologues américains entre-temps devenus de véritables gourous de la Révolution dans les Affaires Militaires (RAM). Quasi-systématiquement cités dans les ouvrages traitant des formes contemporaines de guerre, leur influence sur le Pentagone - au travers de leur participation dans des études telles qu'Air Force 2025 ou Spacecast 2020 - est importante.
Dans un pays où, comme le rappelait V. Desportes, la « Vision » est un élément stratégique dans l'adoption des méthodologies qui conduiront à la mise en place de doctrines et de stratégies, le statut des deux auteurs est incomparablement plus important que celui de n'importe quels autres en Europe.
Au terme d'un cheminement intellectuel d'une dizaine d'années commençant en 1981, A. et H. Toffler avaient suggéré l'irruption d'une nouvelle forme de guerre, dite de « Troisième Vague ». Selon eux, aux guerres formatées sur la base des modes de production agricole et industriel (soit les premières et les secondes vagues) devait succéder une guerre technologique où l'informatique et les armements de précision feraient triompher les forces US.
Dans leur analyse, ils triséquaient ainsi les capacités mondiales en proposant que toute armée formatée sur la base de la troisième vague serait capable de l'emporter sur celles qui relèveraient des deux vagues précédentes.
La phase de haute intensité d'une OIF est présentée comme une victoire décisive autant que comme un exemple parfait des dynamiques engendrées par la RAM, et a fortiori de ce que pouvait produire comme effets stratégiques une armée de la troisième vague.
A présent close depuis plus de quatre mois, cette expérience stratégique décisive, au vu des réflexions qu'elle engendre déjà et des leçons qui en sont tirées dans le cadre de la structuration future des forces américaines, nous permet d'évaluer la congruence de la vision des deux futurologues à la réalité des opérations.
Ce que le conflit irakien semble avoir une fois de plus démontré, c'est la place centrale de l'homme dans les opérations militaires. S'il dispose de systèmes d'armes réduisant sa vulnérabilité, sa survie n'en est pas autant garantie. Le soldat, unité élémentaire du combat, constitue le premier senseur, celui qui recueille et dissémine l'information à travers un commandement - c'est la nouveauté - réseaucentré.
D'aucuns ont promis aux fantassins du futur une exposition minimale, tout en conservant une puissance de feu et une létalité accrue. La réalité qui semble désormais se profiler est quelque peu différente : l'homme, parce qu'il représente non seulement un composant essentiel de certaines opérations (comme la guerre urbaine ou le contre-terrorisme), risque de voir ses responsabilités en matière de décision croître en nature et importance.
En clair, la guerre s'« humaniserait » plus qu'elle ne se « technologiserait ». Bien qu'ils fassent l'objet d'études sérieuses, cyber-organismes et robots ne remplaceront donc pas de sitôt le fantassin et les forces armées devront encore intégrer le risque de pertes humaines dans les temps à venir.
A cet égard, les Toffler étaient loin d'imaginer à quel point le développement des biotechnologies pourrait constituer des multiplicateurs de force potentiels. Mais s'ils ont aussi considéré dans Guerre et contre-guerre la fonction centrale de l'initiative (sur le terrain comme dans la gestion du changement techno-stratégique), ils ont mal appréhendé la fonction combattante en tant que telle.
Les opérations menées dans le cadre de l'OIF montrent ainsi que comparativement aux combattants britanniques, les Américains présentent un déficit d'expérience. Plusieurs études montraient certes leur détermination à combattre et le haut degré de leur moral, mais la jeunesse des soldats du rang - comparativement à l'expérience et aux compétences d'officiers US qui forment un des corps sociaux les plus éduqués au monde - était source d'une nervosité et d'un certain nombre d'incidents.
Dans le contexte d'une guerre visant avant tout le moral des Irakiens eux-mêmes, afin d'éliminer ce qui restait de leur adhésion au régime avant qu'ils ne puissent soutenir les nouvelles autorités, ces comportements contrevenaient aux conditions élémentaires des opérations de maintien et de rétablissement de la paix.
La maîtrise du swarming par l'exemple
Dans cette optique, l'OIF sacre plus que la guerre technologique une certaine forme de retour aux réalités des vraies guerres clausewitziennes qui, si elle est correctement interprétée par les tenants de la RAM, infléchira ses excès de techno-optimisme tofflériens vers plus de réalisme. Dans des forces américaines culturellement marquées par la figure de Jomini et ses notions de rigueur mathématique - des raisonnements autant que de la conduite même des opérations -, la sagesse clausewitzienne n'est que partiellement comprise.
A fortiori, lorsque les planificateurs font face à la réalité des opérations, comme lorsqu'il s'agit de rediriger les flux logistiques ou de sécuriser des positions urbaines, c'est pourtant à des qualités intrinsèquement humaines et clausewitziennes qu'il est fait appel. A l'exception du dépassement d'un nombre considérable de goulots d'étranglements en matière d'intelligence artificielle, les capacités d'initiative, de gestion des incertitudes et d'interprétation d'informations qui ne sauraient rester que fragmentaires (prôner la dissolution technologique du brouillard de la guerre impose des certitudes qu'aucune interprétation ne peut fournir), l'homme y reste le plus adapté.
Aussi, selon Clausewitz, « La guerre est par essence le domaine de l'incertitude » et des épisodes comme les batailles de Nasiryah ou de Najaf le montrent à souhait. Mais ils permettent aussi de montrer à quel point l'entraînement et les tactiques adaptées peuvent payer. Le nombre de pertes américaines en comparaison des pertes irakiennes indique que des tactiques telles que le swarming sont à la fois maîtrisées et constituent des équilibres corrects entre offensive et défensive.
Offensif, le swarming autorise des raids concentriques en direction de l'objectif (tactique comme opératif) supportés par une puissance de feu dispersée mais convergente. Défensif, il ne nécessite pas systématiquement une grande vitesse d'application et autorise des approches prudentes, très fréquentes en Irak. Dans les deux cas, il offre aux combattants la possibilité de se retirer et d'exercer un contrôle lacunaire de la zone d'intervention ou au contraire d'implémenter une domination de zone. La liberté de manœuvre permise reste toutefois conditionnée à un fort degré d'initiative des hommes comme de leurs leaders, mais aussi à un fort degré de compétence technique.
Autant dans le contexte de la RAM que de l'OIF, cette articulation entre l'homme et les pratiques techniques conditionne le succès et constitue un territoire stratégique encore largement en friche. L'intégration des percées technologiques dans les corpus stratégiques et doctrinaux constitue la possibilité d'allier la vision que pouvaient avoir les Toffler de la guerre du futur à la réalité des opérations. A cet égard, l'OIF consacre autant une évolution de la culture de planification des forces américaines - au regard des allégements successifs du plan initial - que de la culture du commandement.
Est tout singulièrement révélatrice de ce phénomène la controverse intervenue quant au format des forces qu'il conviendrait d'engager sur le sol irakien. S'il fallait résumer la teneur de ce débat, nous pourrions affirmer que deux écoles s'opposaient. La première, conduite par le Général Tommy Franks de l'U.S. CENTCOM, envisageait un déploiement de grande envergure, à des lieues des formules révolutionnaires développées par certains avocats « extrémistes » de la RAM.
Cette option ne reçut pas l'aval des membres civils du Département de la Défense, et tout particulièrement de Donald Rumsfeld. La fin de non-recevoir adressée au commandant du CENTCOM - enjoint, au demeurant, de retravailler son plan selon une vision en rupture avec les conceptions classiques en vigueur - avait été motivée par l'évocation des risques que pouvait générer l'expédition d'un tel dispositif militaire dans la région.
La seconde école, conduite par quelques faucons de l'administration Bush, tablait sur le déploiement d'une force expéditionnaire plus réduite (d'environ 70'000 hommes), compensant sa faiblesse numérique par sa dotation en systèmes d'armes intégrant les récentes avancées technologiques en matière de précision, de protection et de létalité. La décision finale quant au format des troupes qu'il s'agirait d'engager traduit clairement un compromis entre les deux thèses en vigueur, même si, à y regarder de plus près, le projet du Central Command semble avoir prévalu.
Prenant alors pleinement appui sur le concept de Network Centric Warfare (NCW), les officiers installés au Camp Al-Salyiah (Qatar) étaient aussi bien en mesure de diriger des opérations de nature très tactiques que d'exercer un commandement par influence. Ainsi, le Combined Air Operation Center était chargé du dispatching des missions d'appui aérien (plus de 80% des missions ont été menées « à la demande »). Si ces évolutions n'ont pas été prises en compte par des Toffler reconnaissant toutefois que leur Troisième Vague aurait des impacts organisationnels, les évolutions technologiques qu'ils percevaient se sont révélées plus nuancées.
Des technologies capacitantes
Les innovations technologiques les plus récentes n'ont pas ainsi occupé le premier plan des opérations. En fait, une part majeure du matériel employé, qualifié par certains d'obsolète ou de vétuste car datant des années 1980 et conceptualisé dans l'optique d'une guerre de large amplitude sur le théâtre centre-européen, a démontré toute son utilité. En ce sens, la seconde guerre du Golfe fut principalement une guerre conduite avec les moyens de la Legacy Force, c'est-à-dire l'ensemble des plate-formes connues traditionnellement pour leur lourdeur, masse et manque de mobilité.
Il semble que les opérations en Irak ont renvoyé la plupart des « prospecteurs militaires » à leurs classiques de stratégie, Fuller, Guderian ou Rommel - dont la stratégie d'évitement des villes entretient d'intrigantes similitudes avec les plans de guerre des forces US. Il n'est, dès lors, pas lieu de s'étonner de l'omniprésence des chars M1A1 et M1A2 Abrams ou encore des véhicules de combat d'infanterie M2 Bradley. Le char classique n'est pas près d'être déclassé, selon les dires d'officiers de l'Army : les programmes de modernisation US - notamment un FCS et des blindés Stryker considérés comme trop légers face aux RPG proliférants - sont d'ailleurs remis en question.
Certains - comme un Ralph Peters très influent et très proche.… des Toffler - attribuent encore un rôle de premier plan au char de combat principal, y compris et surtout dans les villes. La formidable approche adoptée par les Britanniques usant de leurs Challenger II surblindés, dans le cadre de sous-groupements tactiques, a prouvé que le char de combat constituait encore un parfait compromis entre mobilité, protection et puissance de feu.
Au-delà du classicisme de l'emploi des matériels, certains équipements ont par ailleurs révélé de nouvelles potentialités lorsqu'ils étaient combinés à des concepts d'emploi innovants et adaptés. Des bombardiers stratégiques comme le B-52 et le B-1, une fois équipés de pods de désignation adaptés, ont ainsi pu mener des missions tactiques au moyen de bombes JDAM ou guidées par laser. D'autres cependant semblent avoir montré leurs limites dans les combats. Le faible nombre de sorties des F-18 australiens comparativement aux appareils britanniques et américains n'est pas ainsi le fait de la plate-forme, mais de sa non-adaptation aux conditions de travail interarmées.
La gestion d'opérations combinées dans le cadre d'une RAM reste ainsi dépendante de l'adaptation des forces participantes à ces mêmes opérations. Adaptées, elles peuvent être affectées aux mêmes fonctions, mais non adaptées, elle peuvent constituer sinon un poids dans la gestion des opérations, du moins devenir des « demi-forces », une leçon à retenir si les forces européennes veulent poursuivre des coopérations avancées avec les Etats-Unis dans le cadre de l'OTAN. Mais l'exploit technique fut peut-être l'œuvre des forces britanniques qui déployèrent le Canberra PR-9, un avion de reconnaissance photographique, dont la première mise en service remonte à … 1949 (!) et dont les performances lors du conflit se révélèrent plus que satisfaisantes.
La « guerre high tech », toutefois, eut bel et bien lieu. Mais elle fut discrète. De la même manière qu'ils avaient œuvré en Afghanistan, les drones de reconnaissance et de combat furent déployés au cours de l'offensive. Ainsi, la disposition de RQ-1 Predator a permis la surveillance des déserts de l'Ouest irakien, de renforcer la conscience situationnelle des forces spéciales qui allaient y être déployées. Quoique cruciales, ces plates-formes sans pilote ne purent en aucun cas se révéler décisives en raison de limites opérationnelles liées aux conditions météorologiques. De même, leur nombre était insuffisant et de nouveaux systèmes, comme le Shadow 200, ne sont pas encore entrées en service.
L'utilisation effective de concepts mûris ces dernières années, comme le drone affecté à la compagnie et porté à dos d'homme (le Dragon Eye des Marines) ou le télépilotage de drones RQ-4 Global Hawk depuis les Etats-Unis a permis de les valider. A terme, il est donc plus que probable que la fonction des drones se renforcera, d'autant plus qu'ils pourraient être amenés à remplir d'autres missions. Les RQ-4 déployés sur le théâtre des opérations, au même titre que les KC-135 de ravitaillement en vol, disposaient ainsi de palettes permettant le relais des communication au profit de toutes les unités en opérations.
Les munitions à guidage de précision laser et/ou GPS (EGBU et JDAM) occupèrent également une place majeure dans la campagne aérienne de bombardements, même si la victoire ne vint pas des airs. Encore une fois, la capacité à gérer correctement les informations et les renseignements disponibles à toutefois fait ses preuves, faisant tendre la campagne vers une chronocompression. Ainsi, en matière de stratégie aérienne, la réduction de la durée des cycles F2T2EA (Find, Fix, Track, Target, Engage, Assess) à 12 minutes est exemplaire : elle pouvait être de plus de 24 heures durant Desert Storm.
Mais cette capacité n'a pas été uniquement le fait des forces aériennes. L'utilisation d'obus à guidage laser Copperhead a révélé des perspectives d'emploi intéressantes en milieu urbain, alors que l'utilisation de sous-munitions adaptées aux missiles ATACMS a participé à la réduction des divisions de la Garde Républicaine alors qu'elles sortaient de la périphérie de Bagdad et se dirigeaient vers le goulot de Karbala. In fine, cette supériorité technologique avérée à littéralement laminé ce qui pouvait rester des forces terrestres irakiennes.
Une coopération interarmées et multinationale inédite
On a néanmoins pu constater un décalage important entre, d'un côté, le discours jusque là tenu par les avocats d'une RAM fondée sur les technologies de dernier cri et, de l'autre, la réalité du terrain. Sans doute existe-t-il une réticence certaine de la part de l'institution militaire - organisation traditionnellement conservatrice - à intégrer des technologies, matériaux et plate-formes n'ayant pas encore passé l'épreuve du feu. En outre, des résistances d'ordre culturel semblent, de toute évidence, avoir affecté le dosage et la répartition des types d'équipement, et ce dès les premiers préparatifs du conflit.
Paradoxalement, les résistances qui avaient pu apparaître quant à l'intégration des nouvelles technologies furent levées sur un plan structurel, dans l'organisation du commandement et la planification des opérations interarmées et multinationales. La véritable révolution, s'il en fut, s'illustra à travers une coopération inédite entre, d'une part, les services des forces armées américaines (Air Force, Marine Corps, Army et Navy, y compris les Coast Guards) et, d'autre part, les forces coalisées (britanniques, australiennes et polonaises).
Cette coopération interarmées a rendu possible la mise en œuvre des Effect-Based Operations (EBO), produit des conceptions nouvelles en matière de commandement, de contrôle, de renseignement, de surveillance et reconnaissance, mais surtout des potentialités nouvelles issues de la conjonction interservices. Les EBO traduisent, sur le plan opératif, les innovations en matière de guerre réseaucentrique. L'intégration des différentes Armes - et plus particulièrement de l'Air Force et de l'Army -, rendue possible par les avancées en matière de technologies informationnelles et communicationnelles, autorise désormais à gérer, de manière simultanée et isochronique, l'ensemble des dimensions du champ de bataille.
Les concepts de rupture, d'exploitation, de lignes de front et d'arrières ne disparaissent pas pour autant, mais sont reconsidérés dans leur essence. Les EBO reposent sur une synergie des puissances de feu des armes aériennes et terrestres selon un schéma global et commun d'actions coordonnées exerçant sur l'adversaire une paralysie de ses forces et capacités de décision, de commandement et de contrôle. Cet effet fut rendu possible, du côté des forces US, par une contraction, une compression inédite des cycles observation, orientation, décision, action (OODA) - qui furent développés en son temps par le théoricien John Boyd de l'US Air Force.
Par la même occasion, les EBO visèrent à paralyser l'adversaire irakien dans ses représentations mentales des hostilités et de l'évolution des combats. Elles perturbèrent le processus décisionnel de l'opposant - obligeant chez ce dernier un perpétuel retour à la phase observation - et le contraignirent à limiter ses manœuvres à quelques options préplanifiées qui, à défaut d'être en phase avec la marche des opérations qui lui furent imposées, le confortèrent dans des repères surannés. Ainsi le point d'application (Schwerpunkt) fut-il davantage cognitif que physique.
La centralisation décisionnelle au Qatar et la situation de domination informationnelle dans laquelle ont opéré les coalisés leur a permis de littéralement multiplier leurs forces. Des infrastructures de commandement telles que le FBCB2 ou le Blue Force Tracker ont permis un suivi en temps réel de quasiment toutes les forces engagées, permettant aux planificateurs de prévoir les besoins des unités et de travailler à les pallier. Cette « capacité de commandement éclairée » reposait elle-même sur les aspects transversaux développées dans les différentes unités et commandements américains.
Ainsi, une organisation telle que le Strategic Command, qui avait à sa charge la gestion des opérations satellitaires, a permis de rentabiliser au maximum les capacités GPS sur le théâtre des opérations. A ce stade, l'interarméité ne constitue plus seulement une capacité de coopération tactique et/ou opérative, mais aussi une capacité, inscrite dans les fondements organisationnels de toutes les unités activées durant le conflit, leur permettant de réagir comme un organisme intégré, synchronisant les comportements stratégiques.
Si les Toffler se doutent que de leurs conceptions naîtront de nouveaux comportements organisationnels, ils n'approfondiront toutefois pas leur réflexion en la matière. Or, durant l'OIF, c'est précisément cette capacité à opérer de façon interarmées qui a permis de multiplier les forces. Qu'on y songe : la majorité des matériels employés durant la guerre étaient en service aux Etats-Unis, non seulement au moment de la sortie de Guerre et contre-guerre mais aussi au moment de La Troisième vague, en 1981.
Ils ont certes été modernisé depuis lors, mais les équipements ajoutés ou remplacés entre-temps n'ont pas tant été des éléments mécaniques, dynamiques ou balistiques que leurs équipements C3I et, dans une moindre mesure, d'armement (surtout du fait de l'introduction d'armes GPS, mais moins utilisés que des armements laser déjà en service en 1981). Projection sensible et réelle de capacités interarmes virtuelles, elles nous montrent toutefois leurs limites.
Premièrement parce qu'elles ne constituent qu'une partie des infrastructures nécessaires au combat. Si elles le rendent plus létal, elles ne remplacent en aucune manière le combat en tant que tel, qui reste le fait de combattants. Deuxièmement, ces technologies restent d'essence humaine : elles sont imparfaites et n'excluent en aucune manière des engagements fratricides. Qu'on en juge : un F-16, accroché par le radar d'une batterie anti-aérienne Patriot réplique par le lancement d'un missile AGM-88 HARM et le détruit presque complètement. Si ce n'était contre des forces amies, la séquence d'engagement aurait été parfaite. Mais le radar, téléopéré parce qu'il était situé dans une zone de bombardement, a-t-il bien été signalé au pilote ?
Troisièmement, si les engagements fratricides restent possibles, ils induisent eux-mêmes des conséquences organisationnelles : déjà triséqué (en front Nord, Sud et Ouest), le théâtre d'opérations a été partagé en Areas of Responsabilities (AOR) entre des forces de l'Army et des Marines qui ne sont que partiellement interopérables entre elles.
La doctrine comme condition du succès
L'avantage comparatif de la coalition résida également dans l'application d'une guerre de manœuvre et d'audace - le commandement n'hésitant pas à revoir les plans initiaux en fonction de la progression des forces. En d'autres termes, c'est la combinaison des dimensions organisationnelle, structurelle et doctrinale qui a permis la victoire des forces coalisées.
Une leçon majeure doit en être tirée par l'Europe. C'est l'existence d'un corpus organisationnel et doctrinal affiné qui constitue le principal gage de succès. Au vrai, ce constat n'a rien d'innovant ; il avait déjà été pleinement démontré lors de la guerre du Yom Kippour durant laquelle Tsahal remporta la victoire alors même qu'elle n'alignait, par exemple, que 1800 chars contre les 4800 blindés de la coalition arabe.
Le dynamisme conceptuel propre aux Etats-Unis permet, article après article, de constituer une masse de comportements stratégiques en devenir perpétuel, qui peuvent être agrégés en corpus doctrinaux ou qui sont plus simplement laissés à l'emploi des décideurs. A cet égard, les différentes phases du conflit ont montré des éléments de pratiquement toutes les réflexions menées aux Etats-Unis ces dix dernières années. Certaines ont certes été plus mis en valeur que d'autres, pas toujours à bon escient d'ailleurs.
Il y a certes le très médiatique Shock and Awe, un ouvrage passablement mal rédigé, répétitif à souhait et où l'on apprend, par exemple, que les Israéliens ont détruit les réacteurs nucléaires syriens en 1981. Mais il représentait une déclaration d'intentions stratégiques plus qu'une stratégie ou une doctrine en soi. Ses apports sont importants : ils permettent, en prenant appui sur la supériorité technologique US, de tirer parti d'une décapitation très aléatoire - ou relevant de l'asymétrie stratégique.
Il y a aussi des Rapid Decisive Operations (RDO), elles aussi problématiques, moins factuellement que méthodologiquement. La doctrine envisage ainsi des frappes décisives, menées dans la profondeur adverse autant que tactiquement durant toute la durée des opérations, et y compris lors des phases de rétablissement de la paix. Or, comment être décisif contre des pillards ? Dans la reconstruction d'un Etat ? Contre des mouvements terroristes émergeants ? Le gros problème de la vision américaine des la guerre est qu'elle induit par l'intermédiaire technologique l'illusion de la facilité et de la certitude.
A ce sujet, il est bon de rappeler que si les RDO constituent une joint doctrine que chaque service a adaptée à ses propres spécificités, elles ne constituent pas une stratégie en bonne et due forme, qui semble avoir manqué aux Américains : la guerre d'Irak ne peut en aucun cas se résumer à sa seule phase de combat classique. Revenant sur l'opération Overlord qui allait permettre le débarquement en Normandie, Vincent Desportes signalait que toute l'attention américaine s'était concentrée sur la préparation de l'opération plutôt que sur son exploitation. A l'époque, il fallut la poigne et tout le folklorique art du commandement d'un Patton et de quelques autres pour sortir les Alliés du bocage normand. Un peu moins de 60 ans plus tard, la situation pouvait être comparable.
Au regard des objectifs politiques américains (le désarmement de l'Irak par l'élimination du régime), la phase militaire de l'opération est comparable au débarquement : une étape certes indispensable dans leur logique, mais insuffisante, car elle reste à exploiter. Politiquement plus que militairement vendue, la guerre d'Irak est paradoxale, tant du point de vue des Toffler que de celui du stratégiste.
Les premiers, en mettant en évidence les percées technologiques et leurs conséquences sur l'art de la guerre, minoraient des facteurs politiques plus importants que les facteurs militaires à l'époque où ils écrivaient leur ouvrage. Ils donnaient certes plus d'options dans les mains des décideurs, mais leurs donnaient aussi l'illusion de la facilité (en oubliant par ailleurs de préciser qu'aucune guerre n'est facile) dans le règlement des problèmes stratégiques.
Du point de vue du stratégiste, la situation est comparable, dans la mesure où gagner la paix est encore moins facile que gagner une guerre et requiert un investissement politique auquel les Etats-Unis ne semblent pas prêts à consentir. Les réticences à faire l'appel à l'ONU, ou encore le manque de planification de la phase post-guerre - malgré plusieurs études sortant des écoles de guerre US qui en soulignaient la nécessité - sont autant d'erreurs.
Une victoire militaire en demi-teinte
Bien qu'elle révéla l'extraordinaire aptitude organisationnelle, de commandement et de projection des forces coalisées, la guerre en Irak n'en fut pas moins un combat inégal entre, d'une part, une hyperpuissance technologiquement et structurellement sophistiquée et, d'autre part, une armée dégradée par dix ans de frappes mais qui sut toutefois faire preuve d'une grande bravoure lors de certains engagements. Les conditions initiales (avantage comparatif des forces coalisées, terrain favorable aux blindés, supériorité aérienne écrasante) étaient particulièrement exceptionnelles, rappelant la réflexion d'officiers qui avaient décrit Desert Storm, en 1991, comme une « anomalie stratégique ».
En fait, il suffit de se rappeler la campagne d'Afghanistan ou la Somalie pour voir qu'il est peu probable que les prochains conflits où interviendront les Etats-Unis réuniront les avantages dont ils ont bénéficié en Irak. Certes, la stratégie est dynamique par essence, et elle se nourrit d'une expérience que les états-majors dissèquent déjà. Mais plutôt que révolutionnaire, comme le sous-entendaient les Toffler, la stratégie américaine n'est-elle pas plutôt évolutionnaire, même si elle peut progresser d'autant plus vite qu'elle est appliquée ?
La guerre en Irak confirme davantage certains « canons » de la stratégie qu'elle ne les invalide, ce qui ne fait d'elle qu'une préfiguration partielle de ce que pourraient être les guerres du futur. Plus que les fondements, ce sont plutôt leurs interprétations et leurs perceptions qui changent. L'OIF n'a pas sacré la fin des principes de la guerre, des concepts de choc, de mobilité et de feu, des notions de niveaux stratégiques et plus largement de tous les éléments qui constituent la boîte à outil du stratégiste.
Bien au contraire : elle a peut-être sacré ce Clausewitz trop peu reconnu aux Etats-Unis. Il indiquait notamment que la guerre est un caméléon, avec cette connaissance (cette sagesse ?) parfois presque sibylline qui lui est propre. Mais son analogie animalière reste bien plus nuancée que l'éléphant que nous proposaient sans le nommer les Toffler. C'est toute la différence entre le livre enseigné et le livre de chevet.
Joseph Henrotin, doctorant en Sciences politiques à l'ULB © 1998-2003 CheckPoint
Alain De Nève, chercheur au Centre d'Etudes de Défense (Bruxelles)
Membres du Réseau Multidisciplinaire en Etudes Stratégiques (RMES)
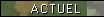

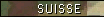
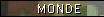

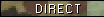
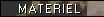


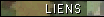

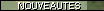


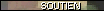
Reproduction d'extraits avec mention de la provenance et de l'auteur